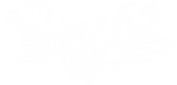En effet, cet immense pays à la stabilité sociale et politique quasi millénaire était ébranlé dans ses fondements les plus solides et les plus anciens : son empereur et son armada de bureaucrates lettrés, qui constituait une immense administration centralisée et éduquée et permettait un contrôle politique direct sur la population de paysans, eux-mêmes fixés à la terre par une agriculture vivrière intensive. Ce sont eux qui entretenaient l’empire et ses mandarins.
Les guerres de l’opium laissèrent le pouvoir impérial humilié et la société chinoise le ventre ouvert. La Chine allait alors connaître près de 100 ans de dépeçage par les impérialistes, de désagrégation sociale, de révoltes et de révolutions : les Taiping, les Boxers, la révolution ouvrière de 1927 pour aboutir après 1945 à la révolution de Mao.
À la recherche d’une autre voie après l’ouverture forcée et les traités inégaux…
Analysant les événements et les échecs de l’empire, les intellectuels allaient chercher un autre avenir pour la Chine. Mais quelle force était assez puissante pour balayer des milliers d’années d’organisation clanique et de soumission ritualisée de millions de paysans ?
L’empire, humilié, perdit toute crédibilité. Pour payer les colossales indemnités de guerre, il ne cessa d’augmenter les impôts, sans pour autant être en mesure d’assurer l’entretien des digues des fleuves ni fournir de secours en cas de famine, tout ce qui était indispensable aux paysans pauvres pour survivre. Aussi, jusqu’à la fin du 19è siècle, ce ne fut qu’explosions de rage des paysans qui ne s’éteignaient ici que pour se rallumer là.
Les familles influentes, comprenant propriétaires terriens et mandarins, nourries du conservatisme de Confucius et d’un fort sentiment de supériorité, voyaient leurs privilèges mis à mal du fait de l’affaiblissement du pouvoir central. Dans cette Chine où les piliers de l’ordre ancien s’écroulaient, leurs enfants n’avaient plus d’avenir. Ceux-ci furent rapidement attirés par les Occidentaux, cherchèrent à s’en inspirer, voire partirent à l’étranger. C’est dans la tête de ces hommes qui se posaient la question de l’avenir de la Chine, que des idées nouvelles allaient naître.
Aveuglée par son conservatisme, l’impératrice Cixi annula en 1898 la réforme de l’empire décidée par son neveu après la défaite, trois ans plus tôt, contre le Japon qui, s’étant modernisé à l’occidentale, avait facilement triomphé des armées chinoises.
C’est au Japon, parmi les étudiants chinois, qu’un courant apparut autour de Sun Yat-Sen et de ses trois principes : nationalisme, démocratie et bien-être du peuple qui, tout en étant des idées trouvées en Occident, étaient imprégnées de traditionalisme chinois.
L’empire finit par tomber. C’est le 10 octobre 1911, que les notables eurent le geste le plus décisif ! À Wuchang, ils refusèrent que le pouvoir s’empare des fonds destinés au chemin de fer et obtinrent le soutien des généraux et des paysans. La révolution se propagea dans le Sud. Les hommes coupaient leur natte - symbole de soumission aux Mandchous – et brûlaient les reliques du culte des ancêtres. C’en était fini de l’empire millénaire qui venait de s’effondrer comme sous les coups imparables d’un puissant tremblement de terre. Il fut remplacé par une république éphémère et le chaos.
Un âge sombre de militarisme et de guerre civile, voilà tout ce que la bourgeoisie, qui n’avait jamais eu d’existence indépendante et était trop liée aux Occidentaux, avait à offrir à la société.
Le vide créé par l’absence de pouvoir central et le chaos qui en résultait permirent cependant le développement d’un capitalisme sauvage avec comme lois, l’argent, le marché traditionnel de la drogue et le cadre du vieux système familial des clans. La bourgeoisie profita même d’un certain âge d’or, quand au cours de la Première Guerre mondiale, la concurrence occidentale diminua, lui donnant momentanément accès aux marchés de consommation. Il en résulta une anarchie digne des premiers âges du capitalisme, multipliée par le gigantisme chinois. Les villes côtières des années 1920 ressemblaient à des tripots. Le journaliste Albert Londres, avec un certain désespoir, décrit ainsi Shanghai : « Ainsi naquit Shanghai de mère chinoise et de père américano-anglo-franco-germano-hollando-italo-japono-judéo-espagnol. […] La piraterie, le jeu, les cocktails – un million de dollars – c’est le nom du cocktail de Shangai – l’opium, la morphine, la cocaïne, l’héroïne trouvent dans Shangai la ville de leur éternel printemps. »1
Irruption et intervention radicale de la classe ouvrière
Ce capitalisme naissant s’accompagnait inévitablement de l’apparition d’une classe toute nouvelle, issue des campagnes, souvent vendue par les chefs de clans et envoyée telle du bétail rejoindre le bagne des fabriques des villes portuaires ; hommes, femmes, enfants étaient mélangés de force avec ceux venus d’autres provinces, parlant d’autres dialectes. Ils vivaient souvent dans de vieux bateaux abandonnés ou des cabanes de bambou, sur le rivage, travaillant jusqu’à 20 heures par jour et donnant parfois la moitié de leur salaire à l’intermédiaire de leur clan, des animaux puants mais utiles, disaient les Occidentaux.
Exacerbée par des conditions de vie inhumaines, pires qu’à la campagne, désarçonnée parce qu’à mille lieux de sa province, de son village, de son clan, cette population, malgré les différences de dialectes, est contrainte de s’entendre dans les fabriques et les bidonvilles. Elle devient instinctivement un milieu combattif, libéré des mille attaches la liant au village et elle se politise. Spontanément, les ouvriers s’organisent dans les syndicats et écoutent les étudiants qui se tournent vers le communisme, eux-mêmes rompant avec la vieille Chine et tout son fatras. Pour eux, il fallait tout changer, ne rien garder. Avec les idées communistes, la révolte trouvait ses mots, ses idées, un but et une classe sociale pour le combat.
La rencontre avec le communisme
Le Parti communiste chinois voit le jour en 1920-1921. La montée ouvrière, elle, a déjà commencé depuis deux ans. Le nombre de grèves passe de 25 en 1918 à 91 en 1922 et le nombre de grévistes de 10 000 à 150 000. Et dans plus de 50 %, les ouvriers gagnent. Un tract du 1er Mai 1924 à Shanghai résume l’état d’esprit des ouvriers : « Le temps est révolu où les ouvriers n’étaient rien d’autre que du fourrage pour les patrons. S’il leur faut une révolution pour céder, ils l’auront ! »2
La classe ouvrière franchit en quelques années des décennies d’histoire du mouvement ouvrier. Elle reconnut les syndicats comme forme élémentaire d’organisation (on comptait plus de 500 000 syndiqués à Hong Kong – Canton en 1925), et le PC chinois comme son parti.
La grève de Hong Kong – Canton et le premier soviet « version chinoise »
En 1925, suite au mitraillage de manifestants à Shanghai, les grèves éclatent tout le long de la côte. À Hong Kong, 100 000 grévistes entreprennent un boycott total des marchandises britanniques. Sous la direction d’un comité de grève élu, les piquets de grévistes contrôlent le passage des personnes et des marchandises. Seuls deux vapeurs réussissent à accoster au lieu des 200 habituels.
Le comité de grève gère tout, depuis l’armement jusqu’aux écoles et aux hôpitaux. Il devient la « version chinoise du soviet des députés ouvriers ». Et Trotsky précisait dans une de ses lettres : « On entend par « version chinoise », non pas une sorte de particularité nationale décisive, mais le caractère d’un stade de développement du système soviétique : c’était un soviet de députés du type de celui qui existait à Ivanovo-Voznessensk en été 1905 », c’est-à-dire le premier soviet de la révolution de 1905.3
Un allié de choix : les paysans locaux
Les paysans, souvent incités par leurs associations, patrouillent le long des côtes et empêchent les navires britanniques de débarquer en douce, puis, lorsqu’un seigneur de guerre essaie de reprendre le pouvoir à Canton, ils coupent ses lignes de ravitaillement, le forçant à battre en retraite. Dans leur combat, les paysans exacerbés par la misère, reconnaissent immédiatement leurs alliés.
La grève de Hong Kong ouvre la révolution de 1925 – 1927 qui d’emblée s’annonce comme une lutte des exploités des villes et des campagnes. Car le radicalisme des ouvriers se double du radicalisme des paysans. Ceux-ci prennent la terre aux propriétaires, les bandelettes des pieds des filles sont arrachées et les dépouilles du culte de Confucius sont promenées dans les rues. Mais en finir une fois pour toute avec l’oppression des campagnes, cela voulait dire nettoyer des « écuries d’Augias » plus sales encore que celles dont Lénine parlait pour la Russie. La classe ouvrière chinoise pouvait guider la paysannerie dans cette voie.
Trahis par le Komintern
Malgré ses promesses immenses, la révolution allait être écrasée par la faute du Komintern (L’Internationale communiste).
Le jeune prolétariat, en pleine expansion, faisait pleinement confiance au Parti communiste, et il le suivit quand il préconisait à ses militants d’aller militer dans le Kuomintang, alors la force nationaliste montante. Mais ce PC alors tout jeune, était sous l’influence de l’Internationale communiste. Nous sommes en 1927 et le Parti bolchevique au pouvoir en URSS, était en pleine lutte de fractions entre ceux qui optaient pour renforcer le pouvoir de la classe ouvrière, dont les trotskystes, et la bureaucratie stalinienne montante qui rêvait d’une stabilité sociale et d’une reconnaissance par la bourgeoisie. C’est presque naïvement et sans doute convaincus qu’ils ne feraient qu’une bouchée des nationalistes du Kuomintang, que les bureaucrates russes lui fournirent armes et cadres militaires, et en prime le soutien du PC chinois. C’était profondément sous-estimer les capacités de nuisance des impérialistes.
Depuis le début de la montée révolutionnaire, Trotsky préconisait au PC de sortir du Kuomintang. Mais le Komintern le força à y rester, à s’y soumettre complètement, à lui servir de « coolies » comme disait son représentant. Quand le dirigeant du Kuomintang, Tchiang Kai-chek, désarma le soviet de Canton – Hong Kong, le Komintern ne réagit pas, puis quand il remonta jusqu’à Shanghai en massacrant les ouvriers soulevés sur son passage, le Komintern demanda aux communistes « de cacher, d’enterrer toutes les armes en possession des ouvriers, afin d’éviter un affrontement militaire entre Tchang Kai-chek et les ouvriers ». Comme le dit Harold Isaacs, « ces directives revenaient à demander aux communistes de Shanghai de poser leur tête docilement sur le billot des exécuteurs »4.
Quand Tchiang Kai-chek arriva à Shanghai, en avril, alors aux mains des ouvriers insurgés, il les désarma puis les fit massacrer. Cet écrasement et la chasse aux communistes dans les mois suivants firent plusieurs centaines de milliers de morts. Vis-à-vis des impérialistes, ce fut l’acte brutal et démonstratif qui permit à Tchang Kai-chek d’être adoubé comme leur homme de confiance. Le Komintern, lui, poursuivit ses relations avec Tchiang Kai-chek, comme si de rien n’était, choisissant de dissimuler cet écrasement des ouvriers, dans le parti bolchevique, en URSS et dans toute l’Internationale.
Chen Duxiu, fondateur et dirigeant du PC, le plus à même de tirer les enseignements, concluait : « Appliquant sincèrement la politique d’opportuniste de la Troisième Internationale ; je suis inconsciemment devenu l’outil de la fraction étroite de Staline ; je n’ai pas pu sauver ni le parti, ni la révolution. Tout cela aussi bien moi que d’autres camarades, devons en être tenus pour responsables. »5
L’échec de la révolution de 1927 élimina pour une longue période la voie prolétarienne, celle qui aurait permis de renverser en profondeur le vieux monde fait de croyances ancestrales et de soumission aveugle aux puissants, où le gros de la paysannerie restait figé dans l’ignorance et la misère.
Après tout, même la bourgeoisie française en 1789, bon gré, mal gré, avait laissé la population paysanne s’attaquer aux vestiges de l’ordre, non seulement aristocratiques mais aussi religieux. Ce choix-là, seule la classe ouvrière pouvait aider la paysannerie à l’accomplir. En 1917, les bolcheviques avaient su se démultiplier pour aller dans les campagnes aider les moujiks les plus écrasés, à s’organiser dans des soviets de paysans pauvres. Seule une classe ouvrière consciente de ses tâches pouvait être capable de cela. Et c’est cette voie- là, qui était d’abord celle de l’éradication de l’ancien monde, pour construire un monde nouveau qui était bouchée ; une voie qui aurait permis de sortir du sous-développement, ce que même la révolution de Mao n’allait pas réussir à faire même si c’est partiellement le cas aujourd’hui pour la population des villes.
Après l’échec de 1927, le PC dans l’errance
Malgré les conseils de Trotsky en 1928, lui-même écarté du pouvoir, de ne pas quitter les villes ni abandonner la classe ouvrière, une fraction du PC dont celle de Mao accepta la situation nouvelle, s’enfuit à la campagne et se tourna vers la paysannerie. Ce fut aussi par la force des choses, un retour aux traditions de la famille et aux habitudes de la province qui trouvaient un écho chez bien des militants à la dérive.
Ce qui a été nommé « armée rouge » ne comprenait que quelques centaines de soldats avec peu de fusils, des paysans dépossédés, des déserteurs et des bandits locaux ; ils devaient vivre sur le dos des paysans et se faire tolérer. À tout prendre, pour les villageois, ces « rouges », qui ne brutalisaient ni ne pillaient pas trop, valaient toujours mieux que les seigneurs de guerre ou les « jambes-de-chien », les fondés de pouvoir du Kuomintang.
La légende raconte que, dans cette période, va croitre un mouvement révolutionnaire paysan. En réalité, les communistes, isolés, vont s’adapter à la paysannerie pour survivre. Pour la moindre denrée comme du carburant, des allumettes, du tissu, du sel, ils dépendaient des marchands, qui étaient en même temps les paysans les plus aisés, les prêteurs, les employeurs. De fait, ils s’appuyaient sur l’organisation sociale existante, sa hiérarchie et ses traditions. Mao eut beau baptiser « Chine soviétique » le Jiangxi, où il avait échoué, il reconnut lui-même que les paysans riches étaient devenus majoritaires dans les postes importants du parti et de l’administration qu’il avait mise en place. Et quand Tchiang Kai-chek envahit la région en 1934, l’expérience tourna au désastre, la population ne soutenant pas du tout le PC.
L’épisode d’une année appelé « Longue Marche » fut une de ces fuites de bandes armées comme il y en eut tant à l’époque. En fait de longue marche, ce fut avant tout celle de Mao vers le pouvoir à la tête du PC. Il réussit à attirer d’autres bandes, parfois se disant communistes, parfois d’un seigneur de guerre en déroute, parfois des débris des armées Kuomintang. Il élimina ses opposants parmi les cadres communistes en lançant contre eux des campagnes d’accusations et beaucoup disparurent… Les autres plièrent. Quand il s’installa au nord, dans les grottes de Yan’an, en 1935, il était devenu le chef incontesté. Certes le parti était réduit à presque rien mais Mao avait forgé un appareil, rigoureusement sélectionné auquel il avait imposé discipline et centralisation.
Naissance d’un sentiment national en Chine
Seuls les lettrés maitrisaient la complexe langue chinoise, le gros de la population paysanne parlant des langues différentes selon les provinces et le sentiment d’appartenance à une même nation n’était pas évident. D’ailleurs, le PC, au temps où il militait dans les villes, se battait pour le mot d’ordre : « Les travailleurs n’ont pas de patrie, pas même des provinces. »
L’intervention militaire du Japon changea la donne. Se voulant la grande puissance asiatique, il se préparait à la future guerre mondiale en fanatisant à l’extrême les troupes, en embrigadant et réprimant la population. Ce sont ses armées qui en 1937 vont débouler en Chine du Sud après avoir envahi la Mandchourie en 1931. Et ce sont les exactions de ces troupes, imbues de leur supériorité, qui vont créer un sentiment d’être chinois petit à petit et dans l’horreur, des atrocités comme le « sac de Nankin », ses 200 000 tués, le viol systématique des femmes et la politique des Trois Tout : « Tue tout, brûle tout, pille tout » en Chine du Nord.
Après 1945…
Le sort de la Chine réglé d’en haut par les grandes puissances
En août 1945, après les bombes atomiques américaines sur le Japon, ce dernier capitula. Commencèrent alors les négociations. Pour les grandes puissances qui décidèrent du sort du monde, la Chine devait échoir au camp impérialiste. Les États-Unis avaient leur homme, Tchiang Kai-chek à la tête du Kuomintang qui avait fait ses preuves. Staline respectant à la lettre les accords de Yalta était d’accord. Mao eut beau négocier avec Tchiang Kai-chek pendant 41 jours pour obtenir un gouvernement d’unité nationale, celui-ci, dès le lendemain, lança ses troupes exterminer les « rouges ». Contre des soldats faméliques et mal armés, et fort de trois à quatre millions de soldats et de toute la puissance logistique américaine, il était sûr de lui.
L’insurrection paysanne change la donne
Pendant l’atroce occupation japonaise, la haine des paysans s’était accumulée. Après le départ des troupes japonaises, ils s’en prirent à ceux qui avaient profité de l’occupation : les mêmes que ceux qui les avaient toujours exploités, grands propriétaires, usuriers… À l’exploitation ancienne et aux exactions japonaises, ils avaient rajouté impôts, taxes, réquisitions, corvées. Les paysans avaient touché le fond de la détresse. Les cadres du PC organisèrent des « séances d’amertume » pour que les paysans racontent.... Mais ils furent vite débordés ; la colère explosait, on attelait aux charrues les seigneurs qui avaient traité les paysans comme du bétail et parfois on alla plus loin. L’insurrection commençait.
C’était un soulèvement que le PC n’avait pas voulu et qui lui posait problème car depuis 1927, pas une fois il n’avait défendu un programme en direction des paysans pauvres. Il se limitait à une réduction de 25 % des baux et des taux d’intérêts, ce qui était suffisamment modéré pour être vu d’un bon œil par la paysannerie riche, sa vraie base sociale. Basculer du côté des paysans pauvres, c’était perdre son soutien ainsi que celui de la bourgeoisie des villes qui avait des intérêts dans la terre. Mais affronter seul les troupes de Tchiang Kai-chek, c’était la mort assurée. Entre ces deux politiques, le PC hésita pendant presque un an. « Finalement, au cours de l’été 1946, des courriers apportèrent aux commissaires l’ordre suivant : partager la terre. Le sort en est jeté. Le Parti communiste avait choisi. Il avait franchi le Rubicon. » 6
Le mouvement paysan allait faire basculer le rapport de force en faveur du PC. Car il était impossible aux nationalistes d’affronter des centaines de millions de paysans prêts à mourir pour la terre.
Les choses vont aller très vite ensuite. Même si Tchiang Kai-chek poursuit la guerre civile, le sol se dérobe sous ses pas. Ses armées se rendent aux communistes, le haut commandement gangréné par la corruption apparaît plus que jamais stupide, incompétent et veule. Dans les villes, la petite bourgeoisie n’attend que les communistes tant elle est écœurée.
Plus que des victoires militaires communistes, il s’agit d’un effondrement complet du régime de Tchiang Kai-chek. C’est l’immense mouvement paysan qui l’obtient, dégageant pour le PC le chemin vers le pouvoir. L’entrée des armées chinoises dans les grandes villes, n’était plus qu’une question de temps.
La passation du pouvoir : l’exemple de Shanghai
Le terrain avait été ameubli : recommandations à la population de rester calme et aux travailleurs de continuer à travailler et de protéger les biens y compris étrangers. Les cadres locaux du PC avaient agité leur réseau (les clans sont si grands…) et organisé des banquets pour les notables qui, à condition de se déclarer patriotes, n’avaient pas de souci à se faire. Bien sûr, les bourgeois les plus riches avaient déjà mis leur fortune à l’abri, tout en laissant sur place un rejeton pour veiller au grain sur leurs biens, le temps de voir comment les choses tournaient.
Pendant ce temps, les crapules du Kuomintang vidaient les lieux, et, la nuit, Tchank Kai-chek, obligeait des files de coolies à porter, sous la menace des fusils, les lingots d’or qu’il volait à la banque de Chine.
Le matin, les troupes paysannes, dûment chapitrées par les cadres du PC, entraient dans la ville.
Conclusion
Après un siècle d’horreurs et de massacres pour les plus pauvres, de déchéance, due à la drogue pour les autres, la Chine venait de connaître une révolution, menée par une armée petite-bourgeoise, dûment formée au cours de deux décennies de guérilla. Elle réussira à liquider les vestiges féodaux les plus criants de la vieille société, à en finir avec des bandes armées dirigées par un seigneur de guerre ou un autre qui, sporadiquement, traversaient toute la Chine, du nord au sud et du sud au nord, et enfin à unifier ce pays déchiré depuis un siècle !
La Chine se dotait d’un appareil d’État complexe, avec les vieux compagnons de la première heure de Mao, des jeunes intellectuels déclassés de la bourgeoisie industrielle et commerçante, des jeunes ruraux venus dans les villes d’abord pour fuir la misère, peut-être pour travailler et surtout pour saisir l’opportunité de se mettre au service du parti. Un appareil constamment endoctriné et souvent épuré.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants impérialistes, en particulier américains, se sont violemment opposés à la révolution chinoise mais n’ont pas réussi à la vaincre ; alors, ils lui ont infligé la meurtrière guerre de Corée de 1950-1953 et ses près de trois millions de morts. Cette fois encore la Chine de Mao résista, contraignant même les Américains à accepter un statu quo. Mais l’impérialisme s’acharnant toujours, il menaça ses côtes, à partir de Taiwan, enfin il lui imposa un blocus, la coupant du marché mondial.
La Chine se trouva alors contrainte de vivre dans une autarcie presque complète. Mao en s’appuyant sur l’appareil d’État qu’il avait mis en place tenta d’y faire face. Mais à quel prix ? Il dut renforcer son État au prix de la surexploitation de la classe ouvrière et du maintien de la paysannerie dans la misère, politique poursuivie par ses successeurs. La Chine garda son indépendance en écrasant les plus pauvres. Mais à l’ouverture du pays, en 1978, il apparut cependant que la Chine avait réussi, malgré tout, à sortir partiellement de l’ornière de l’arriération, en tout cas plus que sa voisine indienne.
Devenue aujourd’hui la sujette de l’impérialisme, la Chine est considérée comme un simple atelier de ses entreprises les plus performantes. Avoir thésaurisé des dollars dans les banques américaines la rend complètement dépendante de l’économie capitaliste mondiale.
Déjà en 1932, Trotsky avait anticipé les conséquences d’une révolution qui ne serait pas dirigée par le prolétariat ; il écrivait à ses camarades chinois qui l’avaient informé de leur renaissance après la terrible répression de 1927 : « Mais la paysannerie, même armée, est incapable de mener une politique indépendante … La paysannerie, qui en temps ordinaire occupe une position intermédiaire, indécise et fluctuante, peut, au moment décisif, marcher soit derrière le prolétariat, soit derrière la bourgeoisie. La paysannerie ne trouve pas facilement la voie vers le prolétariat, et elle ne la trouve qu’après une série d’erreurs et de défaites. La petite bourgeoisie citadine, principalement l’intelligentsia qui intervient d’habitude sous le drapeau du socialisme et même du communisme, constitue un pont entre la paysannerie et la bourgeoisie. »7
À deux reprises déjà, au cours du 20e siècle, l’impérialisme a entraîné l’humanité dans un conflit mondial afin de maintenir sa prééminence sur les peuples de toute la planète et le rapport de force avec ses concurrents.
À notre époque, la grande bourgeoisie devenue impérialiste domine la planète tout entière, en contrôlant toutes les richesses de l’humanité, accumulées depuis près de trois siècles, et en maintenant systématiquement les peuples dans l’arriération. Aujourd’hui, aucun particularisme économique et social n’a d’avenir en dehors de la domination bourgeoise. Même des pays aussi grands que la Chine sont, plus que jamais, dépendants.
L’évolution sociale va dans le sens d’une unification de la planète. Mais cette mondialisation se heurte par maints aspects à la propriété privée de la grande bourgeoisie qui, soutenue par des États puissants gère des fortunes supérieures aux budgets de bien des pays.
La seule classe capable de contraindre la bourgeoisie à rendre gorge et de gérer l’économie à l’échelle mondiale est le prolétariat. Comme disait Trotsky dans la lettre déjà citée : « L’ouvrier s’efforce de résoudre les problèmes à l’échelle de l’État tout entier (lisez collectivité) et selon un plan ; le paysan, lui, aborde tous les problèmes à l’échelle locale… » Aujourd’hui, la rapacité de la bourgeoisie entraîne la société dans l’impasse. Pour en sortir, seul le prolétariat en renversant le pouvoir de la bourgeoisie pourra offrir une perspective à l’humanité.
3 avril 2025
1Albert Londres, La Chine en folie, 1922.
2Harold Isaacs, La Tragédie de la révolution chinoise, 1938.
3Trotsky, Post-scriptum à la lettre à Alsky, 29 mars 1927.
4Harold Isaacs, La tragédie de la révolution chinoise, 1938.
5Chen Duxiu, Appel à tous les camarades du Parti communiste chinois, décembre 1929.
6Jack Belden, La Chine ébranle le monde, 1951.
7Trotsky, La guerre des paysans en Chine et le prolétariat, 1932.