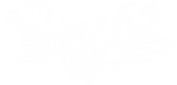La révolution victorieuse des esclaves noirs d’Haïti (1791-1804) est un apport essentiel à l’histoire de l’humanité, à l’instar de la Révolution française de 1789, de celle des ouvriers et paysans de l’empire russe des tsars en 1917 et de la guerre civile victorieuse contre la bourgeoisie qui suivit. Comme ces révolutions, celle des esclaves d’Haïti est une démonstration magistrale que les damnés de la terre, peuvent vaincre leurs oppresseurs.
Au cours de l’histoire de l’humanité, les esclaves, comme toutes les classes opprimées, n’ont cessé de se battre contre l’oppression. À l’époque de l’esclavage antique puis moderne, les révoltes et guerres d’esclaves pour leur liberté furent innombrables. La plus importante révolte d’esclaves de l’Antiquité, menée par Spartacus, fit même vaciller l’Empire romain et ne fut vaincue qu’après plusieurs victoires contre les légions romaines. Menée par des centaines de milliers d’esclaves noirs qui ne comptaient que sur leurs propres forces, la révolution haïtienne est la première révolution d’esclaves de l’histoire qui a triomphé.
De l’esclavage moderne à la révolution
Les esclaves furent déportés, enchaînés par millions pendant deux siècles et demi. Ils subirent une violence inouïe, depuis leur capture sur les terres d’Afrique, dans les navires négriers ensuite, puis lors de la vente sur les marchés d’esclaves des Amériques, et pendant le travail harassant sur les terres des maîtres. Pour maintenir ces hommes dans la condition de cheptel humain, il fallait faire régner la terreur. Au point que les esclaves mouraient trop vite et que le besoin en main-d’œuvre servile était permanent et toujours plus important. La traite en fournissait toujours plus pour remplacer les disparus, particulièrement à Saint-Domingue.
Dans cette île, en 1789, on comptait 500 000 esclaves. Surnommée la « perle des Antilles », elle était la plus riche colonie de la France et rapportait des fortunes aux maîtres d’esclaves, mais encore plus à la bourgeoisie. Rapportant d’immenses profits, le commerce triangulaire fut l’une des sources de l’accumulation primitive du capital en Occident.
Il y eut de nombreuses révoltes d’esclaves à Saint-Domingue. Mais on peut dater le début de l’explosion révolutionnaire des esclaves du 14 août 1791, à partir d’une cérémonie magico-religieuse au lieu-dit Bois-Caïman, qui réunissait une foule d’esclaves d’habitations (plantations) sucrières et d’esclaves « marrons », ceux qui s’enfuyaient et se réfugiaient dans les montagnes où ils vivaient libres et armés. Cette cérémonie eut lieu sous la direction de Boukman, inspirateur de la révolte, qui fut tué au combat plusieurs jours après. En langage moderne, elle fut le premier grand meeting d’appel au soulèvement.
La révolte s’étendit les 21 et 22 août 1791. C’est dans son prolongement, les semaines suivantes, qu’apparaissent pour la première fois les noms des futurs généraux noirs dont Biassou, Jean-François, et Toussaint Louverture, qui fut le principal dirigeant révolutionnaire de Saint-Domingue jusqu’à sa capture en juin 1802. La révolution et la guerre révolutionnaire qui prolongeront cette révolte dureront jusqu’à la guerre d’indépendance dirigée par Jean Jacques Dessalines, qui proclama l’indépendance le 1er janvier 1804.
Le 16 pluviôse an II (7 février 1794), l’esclavage était aboli par la Première République, près de cinq ans après le début de la révolution de 1789. Mais à Saint-Domingue, l’abolition officielle fut proclamée dès le 29 août 1793. Sonthonax, envoyé de la Convention, la décréta sous la pression des masses noires révoltées. Toussaint Louverture était à la tête d’une armée de 4 000 esclaves qui s’étaient libérés sans attendre.
La guerre d’indépendance de Saint-Domingue
Les anciens esclaves ont longtemps craint un retour à l’esclavage, même après l’indépendance. Bonaparte leur donna raison en envoyant en décembre 1801 une armée de 12 000 hommes pour rétablir l’esclavage. Il fit de même en Guadeloupe et en Guyane. La guerre fit rage. Mais, le 18 novembre 1803, l’armée des esclaves noirs remporta la victoire lors de la bataille décisive de Vertières. Des centaines de milliers d’hommes noirs analphabètes, à peine sortis de l’esclavage, mirent en échec l’armée la plus puissante au monde.
Chez les masses haïtiennes, cette révolution fut pleinement consciente. Elles purent en effet se forger une conscience révolutionnaire, une conscience de classe. Elles savaient ainsi qu’elles seules et les chefs qu’elles s’étaient donnés pouvaient aller jusqu’au terme du processus pour ne plus retourner en esclavage. Et elles savaient que pour cela il fallait détruire le système esclavagiste dans l’île, puis prendre le pouvoir elles-mêmes. Pour rien au monde les masses haïtiennes ne voulaient retourner en esclavage. L’indépendance ne fut que la forme prise par le nouveau pouvoir des esclaves libérés. L’histoire postérieure d’Haïti est une autre histoire.
C’est l’armée des esclaves créée par Toussaint qui, au cours des multiples péripéties de cette épopée, permit de pérenniser le rapport de force face à la classe des propriétaires blancs, celle des propriétaires mulâtres, et face à l’État français. C’est cette armée qui fut le parti révolutionnaire des esclaves, comme le livre le montre parfaitement. C’est cette leçon pour les esclaves de notre époque, le prolétariat moderne, que raconte avec brio l’ouvrage de C.L.R. James.
Les Jacobins noirs : Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue est disponible aux Éditions Amsterdam, traduction de Pierre Naville (avec Nicolas Vieillescazes), préface de Laurent Dubois, 2017, 20 euros.
2 avril 2025