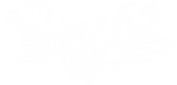Les élections législatives de 2025 : un paysage politique bouleversé
Le bloc conservateur CDU-CSU totalise 28,6 % des voix et arrive en tête. Mais la victoire est en demi-teinte pour son chef de file, Friedrich Merz, qui ambitionnait depuis si longtemps de devenir chancelier, car c’est le deuxième plus mauvais résultat de l’histoire des conservateurs. Merz fut homme d’affaires et, entre 2016 et 2020, président du conseil de surveillance de la branche allemande du fonds d’investissement BlackRock. Ouvertement propatronal, multimillionnaire et se déplaçant en jet privé, il se positionne très à droite sur les questions économiques, sociales et sociétales. Pas encore chancelier, il est déjà impopulaire.
L’AfD (extrême droite) recueille un score en très nette hausse. Sur fond de dégradation de la situation sociale et de mécontentement contre le gouvernement sortant, elle recueille 20,8 % des voix, contre 10,4 % à l’automne 2021. En trois ans seulement, elle double donc son score, et l’élection ayant fortement mobilisé (82,5 % de participation électorale), l’AfD fait même plus que doubler le nombre de ses électeurs. Alors qu’elle n’en finit pas de radicaliser son discours, de multiplier les propos xénophobes, ne reculant même plus devant les clins d’œil au nazisme, elle arrive en deuxième position à l’échelle nationale. C’est la première fois depuis 1949 (naissance de la RFA) pour un parti classé à l’extrême droite, et donc c’était impensable il y a encore quelques années. Le « travail de mémoire », la forte présence du génocide des Juifs et des crimes nazis, dans l’éducation, la vie publique, la muséographie…, a longtemps laissé penser que la population était comme « immunisée » contre l’extrême droite ; et de fait, l’horreur suscitée par ces crimes restait très présente dans la société. En réalité, à défaut d’explication profonde du nazisme, certains ont fini par ressentir cela comme de la morale ; l’extrême droite a même pu s’appuyer sur un sentiment de ras-le-bol face à une forme de rabâchage pour revendiquer le droit, « comme les autres, à une fierté nationale ».
Autre première, l’extrême droite au pouvoir aux États-Unis, E. Musk, J.D. Vance… a appelé à voter pour l’AfD en Allemagne, participant même (en virtuel) à des meetings de sa tête de liste, Alice Weidel. Comme disait un cabarettiste à succès : l’AfD, ce sont des riches qui disent aux pauvres que tout est la faute des immigrés.
Dans le détail, les résultats de l’AfD montrent une Allemagne toujours divisée par son ancienne frontière entre Est et Ouest : dans l’ancienne Allemagne de l’Est (ex-RDA), l’extrême droite totalise plus de 35 %. Elle y est arrivée en tête dans la quasi-totalité des circonscriptions, à l’exception de Berlin, de Weimar et de quelques villes. Parfois, ses scores dépassent 45 %. Lors du précédent scrutin, en septembre 2021, c’était encore les sociaux-démocrates qui y avaient remporté la majorité des sièges. Cela étant, si le score électoral de l’extrême droite est plus élevé à l’Est, où elle partait de plus haut, l’augmentation est tout aussi réelle dans l’autre partie de l’Allemagne, donc à l’Ouest (ex-RFA), en particulier dans les régions marquées par l’augmentation du chômage et de la pauvreté. C’est dire que son influence se généralise. Parmi les raisons de ses succès si rapides, la rage contre la politique des sociaux-démocrates et des Verts au gouvernement, rendus responsables de la forte dégradation économique depuis trois ans et le début de la guerre en Ukraine.
Le parti de l’ancien chancelier Olaf Scholz (SPD), comme ses deux partenaires dans la coalition gouvernementale, s’effondre. Le SPD recueille ainsi 16,4 % des voix, contre 25,7 % trois ans plus tôt. C’est son score le plus bas de toute l’histoire de la RFA.
Le score cumulé des deux grands partis gouvernementaux d’après-guerre, SPD et CDU-CSU, est le plus bas de l’histoire de la République fédérale : il passe pour la première fois sous 50 %. Et cela ne va probablement pas s’arranger, car les jeunes sont encore moins nombreux que les autres à avoir voté pour les partis « établis ». Ceux-ci vont probablement gouverner ensemble, mais cette faiblesse complique leur tâche. Ces résultats, marqués par l’émiettement de l’électorat et une forte montée de l’AfD, approfondissent l’instabilité politique. Ils n’ont cependant pas tant surpris ni choqué, tant ils étaient conformes aux sondages.
Une peur de l’extrême droite toujours vive en Allemagne
Le choc, ou même l’électrochoc, avait eu lieu quelques semaines plus tôt. Le 29 janvier, le chef de file et candidat de la CDU, Friedrich Merz, s’est appuyé sur les députés de l’AfD pour faire adopter une motion s’attaquant aux étrangers sans papiers ou en situation irrégulière : la motion exigeait le renvoi (illégal) de ces étrangers, demandeurs d’asile compris, à la frontière, et visait à faciliter leur placement dans des centres de rétention et leur renvoi. La motion fut adoptée avec les voix de la CDU-CSU, de l’AfD et du FDP (libéraux). Dans une campagne électorale pendant laquelle pratiquement tous les partis ont glissé vers des positions antimigrants, Merz pensait faire un coup, une démonstration de force.
Il a brisé là un tel tabou que ce vote a provoqué des réactions indignées, un tollé au Parlement et surtout d’immenses manifestations dans tout le pays, des centaines de milliers de personnes défilant contre le danger d’extrême droite et contre cette politique de l’apprenti sorcier Merz. Cela a réveillé chez beaucoup une grave inquiétude et le souvenir du début des années 1930, lorsque des gouvernements toujours plus droitiers ont fait la courte échelle aux nazis. Même Angela Merkel est sortie de sa réserve pour le critiquer.
Résultat, lors d’un deuxième vote, le 31 janvier, cette fois pour ou contre un projet de loi de la CDU visant à restreindre l’immigration et à durcir les conditions du regroupement familial, les députés de l’AfD ont bien suivi le futur chancelier Merz, mais douze députés de son propre parti, la CDU, ont refusé de voter pour sa loi, ce qui est une première depuis 1945. Finalement, la loi de Merz a été rejetée au Bundestag (le Parlement), Merz lui-même a été la cible de vives critiques, dont certaines venues de son camp. Son pari était raté. Le projet de loi a pourtant recueilli les voix de l’AfD, de la CDU-CSU, du FDP et cette fois également de BSW, la gauche dite antimigrants. Il a obtenu 338 votes pour et 349 contre : c’est dire que le résultat était serré, et si Merz ne l’a pas emporté sur cette loi inique, c’est parce que des députés des trois partis CDU, FDP et BSW ont refusé la discipline de vote de leur parti, refusé d’approuver cette loi, et surtout d’apparaître comme alliés de l’AfD. Depuis lors, Merz répète qu’il exclut toute alliance avec l’AfD, mais, depuis cet épisode plus encore qu’auparavant, bien naïf qui voudrait y croire.
Après l’élection, en Trump aux petits pieds, Merz s’est vengé des manifestants : il a lancé une procédure judiciaire pour que les associations ayant appelé aux manifestations contre l’extrême droite et contre lui-même – Omas gegen Rechts (les mamies contre l’extrême droite), Foodwatch, ligues de protection des animaux ou réseaux de journalistes critiques –subissent des baisses drastiques de subventions, voire n’en reçoivent plus du tout. Le prétexte est qu’elles seraient en réalité au service des sociaux-démocrates, et relèveraient donc du financement des partis.
Dans les grandes manifestations du mois de février contre l’extrême droite et contre Merz, auxquelles divers partis, SPD et Verts en particulier, ne se sont pas sentis gênés de participer, le parti de la gauche dite radicale, Die Linke, est apparu comme le seul à incarner de manière sincère et crédible ces manifestations. En effet, dans ses thèmes de campagne (précédant le 31 janvier), ce parti était le seul à refuser explicitement de se laisser entraîner sur le terrain antimigrants de l’AfD. Parmi les « grands » partis, seul Die Linke dénonçait ceux qui rendent les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, responsables des problèmes que traverse l’Allemagne. Bien entendu, ce parti au pouvoir dans des exécutifs régionaux n’a pas mené une politique bien différente des autres. Mais, dans sa campagne, Die Linke avait au moins choisi de dire non à la politique d’austérité des grands partis, non aux livraisons d’armes, à l’armement massif, à la guerre comme seule perspective, et clairement non à la chasse aux migrants, non au fait de faire des immigrés des boucs émissaires.
Or son score a fortement progressé, passant de moins de 5 % à 8,8 % des voix, soit 4,4 millions d’électeurs. Faisant suite aux manifestations, le message du vote pour Die Linke était assez clair. Die Linke réalise son meilleur score dans la capitale, Berlin, et y devient, pour la première fois, le premier parti, avec 19,9 % des voix (11,5 % en 2021). Die Linke devient aussi le premier parti parmi les jeunes, qui lui accordent un quart de leurs suffrages. Le succès n’est pas électoral seulement, puisqu’il aurait connu plus de vingt mille adhésions. Reste la question de savoir pour quelle perspective, et pour combien de temps.
En revanche, le Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW, Alliance S. Wagenknecht), parti issu d’une scission, en 2024, de Die Linke, présenté dans la presse comme un « phénomène » depuis sa réussite aux élections européennes, ne totalise que 4,97 % des voix, et rate d’un cheveu (de 0,03 %) l’entrée au Parlement. Or il s’est créé justement sur la conviction que Die Linke était condamnée à la dégringolade parce qu’elle ne s’en prenait pas à l’immigration, et beaucoup de commentateurs voyaient Die Linke comme moribond pour cette raison : son « déni des réalités ».
Cette fois, c’est au contraire le BSW qui semble payer son positionnement, ses campagnes odieuses contre les migrants, d’où son surnom de parti de gauche antimigrants. Cela étant, le BSW n’est pas que cela, Sahra Wagenknecht, s’appuyant sur un sentiment répandu notamment à l’Est, cherche aussi à marquer des points par un discours pacifiste, contre la guerre à la Russie, et a pris position en paroles contre le soutien aux massacres perpétrés par Israël, ce qui est nettement à contre-courant des autres partis. Cela étant, elle s’en remet à la diplomatie : c’est dire qu’elle ne s’en prend pas aux racines des problèmes.
Et bien sûr, le BSW ne remet pas en cause la politique impérialiste de l’Allemagne, il conteste seulement le choix de ses partenaires, voulant se rapprocher de la Russie pour le bien de l’économie, donc du patronat allemand. Ainsi, et sur le fond c’est vrai aussi de Die Linke, les deux partis dits de gauche restent nationalistes, au sens où leur problème et leur manière de raisonner restent que « l’Allemagne » s’en sorte, que « l’économie allemande » soit renforcée, sans demander qui cela recouvre, donc au détriment de tout raisonnement en termes de classes sociales.
Vers une nouvelle grande coalition CDU-SPD : d’accord pour une augmentation massive du budget militaire
Déjà avant les élections et encore plus depuis, Merz agit comme s’il était chancelier, alors même que le nouveau Parlement, qui doit l’élire, n’était pas encore en place. Si les négociations entre CDU-CSU et SPD, dirigées par le premier, vont bon train, cette alliance ne possède qu’une majorité parlementaire relative.
Merz prévoit de nouvelles dépenses massives pour l’armement et l’armée, chiffrées à plusieurs centaines de milliards d’euros. Pour les financer, il veut augmenter la dette publique. Or jusqu’à aujourd’hui, l’Allemagne était nettement moins endettée que ses voisins, notamment la France. Les montants en jeu sont si colossaux qu’un amendement à la Constitution a été nécessaire pour assouplir la règle, jusqu’ici considérée comme intangible, du « frein à la dette ».
Un tel amendement exigeant une majorité des deux tiers au Bundestag, la CDU-CSU a bénéficié du soutien des Verts, venus prêter mainforte aux conservateurs et aux sociaux-démocrates pour faire passer l’assouplissement des règles d’endettement. La validation du plan a eu lieu le 18 mars.
Deux singularités frappent dans cette démarche. D’une part, Merz a fait voter cet amendement non pas par le Bundestag nouvellement élu, mais par l’Assemblée sortante. Et pour cause : dans la nouvelle configuration parlementaire, il n’aurait pas facilement obtenu la majorité des deux tiers requise. Profiter ainsi des dernières semaines du Parlement sortant a suscité de vives critiques, certains dénonçant un tour de passe-passe politique.
D’autre part et surtout, l’assouplissement du frein à l’endettement ne concerne que les dépenses militaires et sécuritaires : tous les autres secteurs restent soumis aux restrictions budgétaires, ou vont l’être encore davantage.
Durant la campagne électorale, la CDU-CSU affirmait encore : « Nous conservons le frein à l’endettement prévu par la Loi fondamentale. Les dettes d’aujourd’hui sont les augmentations d’impôts de demain. » Une semaine après, Merz déclarait pourtant vouloir un réarmement « quoi qu’il en coûte ». Les dépenses militaires servent aussi de prétexte à une austérité massivement aggravée, avec des coupes drastiques dans les allocations chômage et l’ensemble des services publics.
Les grandes entreprises du secteur, les géants de l’acier et de l’armement, se frottent les mains : grâce aux commandes d’État, leurs profits explosent. L’action du groupe Rheinmetall, par exemple, a bondi de 250 % en seulement deux semaines. Et ce, après une hausse de 600 % déjà enregistrée depuis le début de la guerre en Ukraine.
Un autre aspect marquant, mais nullement surprenant pour les Allemands, concerne l’évolution des Verts. Longtemps fers de lance du pacifisme, ils sont devenus, une fois au gouvernement, les plus fervents défenseurs de la course à l’armement et parmi les plus bellicistes, notamment contre la Chine et la Russie. À tel point que, même après s’être effondrés électoralement et avoir été couverts de mépris et d’invectives par Merz, ils ont aidé le même Merz et la CDU à faire passer les dépenses massives en faveur de l’armée.
Le 21 mars, la Chambre haute composée de représentants des gouvernements régionaux a elle aussi validé l’exemption au « frein de la dette » avec plus de deux tiers des voix. Et ici ou là, maintenant les législatives passées, CDU et SPD ont même pu compter pour cela sur les voix de… Die Linke. Elle participe ainsi à deux gouvernements régionaux qui, en approuvant l’augmentation des dépenses militaires, ont fait pencher le vote. Un mois après l’élection, Die Linke a une fois de plus montré à la bourgeoisie et aux partis gouvernementaux combien elle est responsable, et qu’ils pourront compter sur elle.
Investir dans les infrastructures
Cependant, le futur gouvernement prévoit en outre la création d’un fonds spécial de 500 milliards d’euros de crédits sur douze ans, consacrés aux investissements dans les infrastructures : ponts, routes, réseaux ferrés, numériques et énergétiques, mais aussi écoles et maternelles.
L’état de ces infrastructures est en effet déplorable. Les établissements scolaires, en particulier, sont souvent dans un état lamentable. Les chemins de fer accumulent les retards, les ponts en mauvais état obligent à des détours interminables sur des réseaux déjà saturés, et les embouteillages sont devenus un fléau quotidien. Face à cette réalité, beaucoup se disent : « Des ponts qu’on puisse emprunter, pourquoi pas, cela changerait ! »
Mais pour le gouvernement, la priorité est avant tout économique. Il s’agit de fluidifier le transport des marchandises, d’éviter des détours coûteux et surtout de relancer l’économie en offrant des contrats aux grandes entreprises, notamment du BTP ou de l’électricité. Et certains hommes politiques déclarent carrément : « Nous n’avons pas seulement besoin de chars, mais aussi de routes et de ponts qu’ils puissent emprunter. »
Au moment où le gouvernement parle d’investir pour les infrastructures, la population voit combien tous les services publics reculent. Le démantèlement du système de santé s’accélère : des lits hospitaliers, des services ferment alors que la crise sanitaire de 2020 avait justement démontré l’importance d’avoir une réserve de lits de réanimation et d’hospitalisation disponibles. Rénover un hôpital pour le fermer peu après n’a aucun sens. Or, le précédent gouvernement a annoncé la suppression de près de 30 % des hôpitaux ! Quant à l’éducation, quelques écoles modernes où les élèves seraient équipés de tablettes, pourquoi pas ? Mais si les enseignants manquent, à quoi bon ? Si le futur gouvernement veut investir enfin dans les infrastructures, il continue de serrer la vis aux salariés. Salaires, chômage, retraites, services publics : économies et austérité restent la règle. Aux centaines de milliers de travailleurs du public, dans les crèches, les transports urbains, le ramassage des ordures, les hôpitaux, qui viennent de revendiquer des augmentations de salaires et plus de personnel, la réponse est « non ». Le futur gouvernement planifie de nouvelles sanctions et restrictions contre les bénéficiaires du Bürgergeld (revenu citoyen, équivalent du RSA), ainsi que des attaques concernant le temps de travail, pour contraindre tout le monde à travailler toujours plus, dans des conditions de plus en plus dures. Il discute aussi d’introduire un jour de carence en cas d’arrêt maladie (qui n’existe pas jusqu’ici). Aucune initiative, bien sûr, ne vise à améliorer la situation des retraités, dont 20 % vivent sous le seuil de pauvreté, ni celle des enfants, dont 14 % connaissent la même situation.
La situation économique
Depuis l’automne 2024, les annonces de licenciements massifs se sont multipliées dans les secteurs industriels les plus importants du pays : l’automobile, la chimie et la sidérurgie. À ces suppressions d’emplois s’ajoutent des cascades de fermetures, des faillites frappant les sous-traitants et les plus petites entreprises.
La dégradation économique et sociale s’accélère. Dans l’automobile, Volkswagen (VW) a annoncé la suppression de 35 000 postes, Audi (filiale de VW) prévoit 7 500 suppressions d’ici à 2029, tandis que Daimler, Mercedes et Ford réduisent également leurs effectifs. Les travailleurs des sous-traitants ne sont pas épargnés : Continental, Bosch, ZF… font tous des annonces dans le même sens.
Dans l’industrie chimique, BASF, Bayer et Evonik suppriment également des postes. Comme la sidérurgie, notamment Thyssenkrupp. Ce ne sont pas seulement les géants de l’industrie qui suppriment des emplois, mais aussi les entreprises de taille moyenne et, par ricochet, leurs fournisseurs et partenaires.
Désormais, même la production industrielle recule. Si le ralentissement économique s’est amorcé dès 2018, la situation s’est nettement aggravée depuis la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie en 2022. L’Allemagne, historiquement liée à la Russie sur le plan économique, subit de plein fouet les conséquences des sanctions et les difficultés d’approvisionnement énergétique. À cela s’ajoutent une concurrence chinoise de plus en plus sévère et la politique protectionniste des États-Unis, qui fragilisent encore l’industrie allemande.
Face à cette détérioration, l’inquiétude grandit au sein de la population. La crainte du chômage et d’une dégradation continue des conditions de vie alimente des discours du type « l’Allemagne est en train de s’effondrer ». La montée de l’AfD, des discours politiques toujours plus décomplexés dans le monde, s’accompagnent d’une détérioration du climat politique : les tensions s’exacerbent, avec la naissance d’un climat marqué par la brutalisation des relations sociales. Il y a eu une série d’attentats, mais aussi diverses agressions physiques contre des élus ou des candidats. Alors que le débat politique était, ces dernières décennies, assez mesuré en Allemagne, les attaques deviennent plus frontales.
La classe ouvrière est la grande absente. Dans le monde ouvrier, les divisions se multiplient : pour ou contre Trump, pour ou contre l’armement, l’introduction du service militaire, l’AfD, l’expulsion des migrants… En somme, les élections allemandes de 2025 marquent une nouvelle étape dans la crise que traverse le pays. Entre une extrême droite en progression, un gouvernement d’austérité préoccupé de renforcer l’appareil militaire et de subventionner le patronat et la dégradation de la situation économique, l’Allemagne entre dans une période d’incertitude. Le monde du travail serait seul à même de jouer un rôle progressiste. Dans les luttes pour les salaires, les retraites et la défense des services utiles à la population, une autre voix, et par là une autre perspective générale, pourrait émerger, portée par ceux qui refusent de voir les salariés vivre toujours plus mal à seule fin d’enrichir une poignée de grands actionnaires.
24 mars 2025