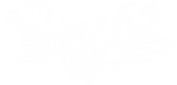Le président américain promet, en vrac et dans le désordre, de reprendre le canal de Panama, d’intégrer le Canada dans l’Union et de s’emparer du Groenland de façon à contrôler la route du Nord autour du pôle, de faire construire à tout va de grands et splendides navires par les chantiers américains, de recruter des équipages américains, de taxer à chaque escale aux États-Unis tous les cargos construits en Chine, venant de Chine, transportant des marchandises chinoises ou en rapport quelconque avec des entreprises chinoises. Trump avance le chiffre faramineux d’un million de dollars de taxe à chaque escale.
Les réponses des intéressés ont été aussi différenciées que les propositions. Les propriétaires des chantiers navals américains ont évidemment déclaré qu’ils étaient prêts, pour peu qu’on les inonde de subventions, à construire tous les bateaux que le président voudrait et ont parlé de « moment historique » (cité par Le Marin du 10 mars). L’armateur français Saadé, propriétaire et dirigeant de CMA CGM, troisième groupe mondial du transport par conteneurs, a été reçu à la Maison Blanche. Il y a annoncé, devant les caméras et sous l’œil de Trump, 20 milliards de dollars d’investissements dans les ports américains et il promet d’étudier, mais d’étudier seulement, la possibilité de faire construire des bateaux aux États-Unis. Le premier armateur de porte-conteneurs, MSC, allié au fonds américain BlackRock, veut racheter, pour 20 milliards de dollars également, les 43 implantations portuaires du groupe hongkongais Hutchison, dont celles du canal de Panama.
Toutefois, l’ensemble des armateurs du monde, dont MSC et CMA CGM, a protesté officiellement le 24 mars contre le projet de taxes à l’entrée des ports américains. Ils avaient été précédés par nombre de groupes américains des transports, de l’industrie et de la distribution. Le gouvernement chinois s’était, dès le premier jour, élevé contre les éventuelles taxes à l’arrivée aux États-Unis, mesures qui visent directement son économie et ses entreprises.
De la première à la 21e place
Les déclarations fracassantes de Trump font suite, sous une forme certes toute personnelle, à une campagne de responsables politiques américains sur le réarmement maritime. Le dernier acte, avant les interventions de Trump, en a été, en décembre 2024, le vote d’une loi portée conjointement par des sénateurs démocrates et républicains, pour aider les chantiers navals. Il s’agirait de relancer la construction navale américaine et de la porter à terme au niveau des chantiers chinois. Cette loi prévoit un dégrèvement d’impôts de 25 % pour tout investissement en ce sens, l’obligation pour le gouvernement de recourir aux armements maritimes américains et des incitations financières en direction des industriels et des agro-industriels américains pour qu’ils fassent de même. Trump a traduit cela quelques mois plus tard en « Je vais ressusciter la construction navale américaine » (déclaration devant le Congrès le 4 mars).
La construction de navires de commerce aux États-Unis a en effet régressé, de la première place mondiale en 1950 à la 21e aujourd’hui. Alors que les chantiers chinois fabriquent la moitié du tonnage mondial, les États-Unis n’en produisent que 0,5 %. En 2024, les chantiers chinois ont même capté 71 % des commandes de navires neufs ! Si la valeur totale de la flotte de commerce américaine la place encore au quatrième rang mondial, c’est parce qu’elle inclut, pour plus de la moitié du total, le prix de la flotte d’énormes navires de croisière, véritables et luxueuses villes flottantes. Cela revient à inclure Disneyland dans l’appareil industriel…
Il faut remonter dans le temps pour comprendre pourquoi la première puissance économique, financière et militaire n’est plus en 2025, et de très loin, à la tête de la première flotte de commerce, et le problème délicat que cela lui pose. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les États-Unis étaient devenus l’impérialisme dominant, dans le secteur de la marine marchande comme dans tous les autres. Ils avaient même trop de cargos, car la guerre s’était arrêtée trop tôt, alors que les commandes faites aux chantiers navals en vue du pont maritime vers le front n’étaient pas toutes livrées. Les chantiers livrèrent des cargos commandés par l’armée jusqu’en 1923. Ils avaient acquis à ce moment la capacité de sortir des navires à la chaîne, comme des petits pains, mais saturèrent le marché. Le gouvernement fit alors adopter une loi maritime, le Jones Act, calquée en fait sur les lois de monopole des vieilles puissances coloniales. La France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas offraient l’exclusivité du trafic maritime entre la métropole et ses colonies à leurs compagnies maritimes, leur garantissant une confortable marge et les débarrassant de toute concurrence.
Le Jones Act : protectionnisme maritime
Le Jones Act de 1920 stipule que le trafic maritime de cabotage entre les différents ports des États-Unis et leurs possessions outre-mer est réservé à des compagnies américaines, utilisant des navires construits par des chantiers navals américains, manœuvrés par des équipages au moins aux trois quarts américains. L’immensité du pays, ses énormes ressources en matières premières, son tissu industriel, sa production agricole mécanisée et massive, l’ouverture en 1914 du canal de Panama, propriété américaine, tout concourait à faire de ce monopole maritime une affaire magnifique. Elle le fut en effet et elle l’est restée jusqu’à nos jours, car le Jones Act est toujours en vigueur. Le secteur maritime américain représente 500 000 emplois et 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires (données du ministère de la Marine français). Les petites choses se logeant dans les grandes, il n’est pas inutile de préciser que Wesley Jones, le promoteur de cette loi, était sénateur de l’État de Washington, et donc de Seattle. Sa loi offrit aux armateurs de ce port l’exclusivité du commerce avec l’Alaska.
Le Jones Act stipule de plus que la marine marchande sous pavillon américain peut et doit s’intégrer très vite, navires et équipages, à la marine de guerre en cas de besoin, et demeure en toutes circonstances à la disposition de l’État. Les marins et officiers de la marine marchande constituent ainsi le vivier naturel de la marine de guerre. C’est, là encore, une disposition calquée sur celles des vieilles puissances, en particulier sur les lois maritimes de Colbert.
Les chantiers navals américains firent une nouvelle fois la preuve de leurs capacités pendant la Deuxième Guerre mondiale en fabriquant des navires, les fameux Liberty ships (« navires de la liberté »), à la chaîne, plus vite que ne pouvaient les couler les sous-marins allemands et les avions japonais. Au sortir de cette guerre, la domination de l’impérialisme américain était écrasante. Ainsi, jusqu’aux années 1970, les navires, les compagnies et les équipages américains étaient prépondérants sur toutes les mers du globe. Mais, à partir de 1981, arrivèrent les lois Reagan de dérégulation, dans le maritime comme dans le reste de l’économie, la possibilité de plus en plus large d’avoir recours aux pavillons de complaisance, en même temps que l’explosion du trafic maritime due à la mise sur le marché mondial du prolétariat chinois par Pékin et la percée progressive des chantiers navals au Japon, en Corée du Sud et, finalement, en Chine.
Alors que, à l’abri du Jones Act, les chantiers américains continuaient à produire peu, cher et lentement pour le marché intérieur, les armateurs océaniques faisaient construire en Asie de plus en plus de navires, de plus en plus grands, pour un trafic toujours plus intense. Bien qu’ayant inventé et imposé le conteneur, les armateurs américains trouvèrent le secteur trop peu rentable et laissèrent se constituer des mastodontes, dont les trois premiers sont européens, et qui ont racheté leurs concurrents américains. Il est exact que le secteur a rapporté moins que d’autres des années durant et que CMA CGM, par exemple, n’a survécu que grâce à ses excellentes relations avec l’État français. Mais, ayant acquis le monopole du transport de conteneurs dans une économie intégrée à l’échelle de la planète, MSC, Maersk et CMA CGM furent à même, à l’occasion des à-coups de la crise du Covid, de rançonner jusqu’aux capitalistes américains. Cela valut au monde étonné un discours du président Biden s’insurgeant contre les monopoles et les positions dominantes qui permettent de détrousser le public.
La prépondérance des chantiers navals asiatiques et des compagnies européennes de porte-conteneurs ne signifie évidemment pas que le capital américain a disparu de la surface des mers, par où passe 90 % du commerce mondial. D’abord, toutes les compagnies américaines de taille mondiale, les pétroliers Exxon et Chevron, les agro-industriels Bunge, Cargill ou Chiquita, les compagnies minières, etc., ont leur flotte pour transporter leurs produits. Mais leurs navires sont le plus souvent affrétés, c’est-à-dire loués, sous pavillon de complaisance, manœuvrés par des équipages internationaux et évidemment non soumis au Jones Act. De même, des capitaux américains sont présents dans bien des compagnies non américaines, à commencer par celles des fameux armateurs grecs, dont les actions sont cotées à Wall Street et qui vivent aux États-Unis, au plus près des bureaux de leur compagnie de droit grec, libérien ou panaméen. Autre exemple, dans la galaxie des avoirs du trust J.P. Morgan, une des dynasties capitalistes américaines les plus anciennes et les plus puissantes, on trouve 140 navires de commerce dont, en 2024, deux méthaniers tout neufs immatriculés au RIF (registre international français), le pavillon français de complaisance favori de CMA CGM. Ces flottes et ces équipages échappent complètement à l’État américain, puisque non soumis au Jones Act.
Un outil industriel insuffisant ?
En période normale, à part le désagrément de s’être laissé doubler dans le trafic des conteneurs – mais l’alliance MSC-BlackRock est peut-être en train de résoudre le problème – la situation n’a pas de quoi inquiéter le capital et l’État américains, ni de quoi menacer leur emprise sur la planète. Mais, dans l’optique d’une confrontation militaire avec la Chine, c’est une tout autre affaire.
Certes, la flotte de guerre américaine est, de très loin, la plus puissante du monde, par le nombre, la puissance de feu, la technologie et même par le fait qu’elle est la seule à faire la guerre en continu depuis des dizaines d’années. Les peuples d’Irak, d’Afghanistan, de Libye et tant d’autres ont payé cher pour le savoir. Pour ne parler que des grands porte-avions, les États-Unis en possèdent onze, en quasi-permanence à la mer et équipés de l’armement le plus moderne ; la Chine en aligne trois, dont un acheté d’occasion à la Russie, et un encore en période d’essai. Pourtant, disent les sénateurs, qui ont fait passer la loi de décembre 2024, et nombre d’analystes américains, cette avance se réduit très vite devant la progression de la marine chinoise. Il n’y aurait ni assez de chantiers navals pour former des ouvriers qualifiés en nombre suffisant, ni assez de bateaux embauchant des matelots américains pour constituer un vivier suffisant pour la flotte de guerre, même en temps de paix. Les accidents survenus ces dernières années sur des bâtiments de l’US Navy seraient dus à la fatigue chronique d’équipages en sous-effectif permanent. Les réparations traîneraient en longueur faute de personnel. Il est avéré que certains bateaux de l’US Navy sont réparés et entretenus sur des chantiers coréens et japonais. La position de rentier induite par le Jones Act aurait fait reculer l’industrie navale dans son ensemble, et les analystes déplorent que la construction d’un porte-avions, qui prenait un an en 1942, en demande dix aujourd’hui.
En cas de conflit ouvert avec la Chine, la marine américaine, certainement supérieure au début du conflit, serait incapable de remplacer les navires détruits et les équipages sacrifiés, alors même que la puissance industrielle chinoise produirait de plus en plus de navires et que ses équipages se qualifieraient. Le très pondéré bimestriel du département d’État Foreign Affairs (« affaires étrangères ») développe cette analyse dans un article de mars 2025 intitulé « Est-ce que l’Amérique fait face à un fossé naval avec la Chine ? » en remontant jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. En 1941, une flotte japonaise expérimentée et moderne avait bombardé la flotte américaine à Pearl Harbor. Mais celle-ci, appuyée sur une puissance industrielle supérieure, avait fini par l’emporter. Alors que l’industrie japonaise peinait à seulement remplacer les navires coulés, les chantiers navals américains lançaient en trois ans 2 710 Liberty ships et, entre autres, 28 porte-avions. Et Foreign Affairs de conclure que l’état présent des chantiers navals et de la marine marchande américains placerait le pays en situation de faiblesse devant la puissance industrielle chinoise, quelle que soit la supériorité immédiate de l’US Navy.
Face à la Chine
La loi de décembre 2024, les discours de Trump et les campagnes médiatiques et politiques sur le réarmement maritime prennent alors tout leur sens, le président exprimant de façon outrancière et provocatrice ce que les autres politiciens expriment de façon rationnelle (à condition de penser que la préparation de la guerre est une activité rationnelle). Les délires sur les taxes à un million de dollars l’escale ne semblent être, comme le reste des discours de Trump sur les taxes douanières contre le Canada, le Mexique, l’Europe et le reste du monde, que des épisodes d’une négociation en cours. Il en ressort une seule politique, même si elle est énoncée différemment : les États-Unis doivent se préparer dès aujourd’hui à solder par les armes leur rivalité commerciale avec la Chine, en étant capables d’aligner le plus vite le plus grand nombre de porte-avions, destroyers, sous-marins, matelots pour les utiliser, et les ouvriers pour les construire, les ravitailler, les armer et les réparer. Ils doivent pour cela mettre les fonds nécessaires, par centaines de milliards de dollars, pour recréer l’outil industriel et humain capable de faire face. Les capitalistes américains ayant laissé en un demi-siècle détruire cet outil dans leur recherche de la rentabilité immédiate, l’État va seul faire les frais de sa reconstruction. On ne parle en effet seulement aujourd’hui que de faire payer la population américaine, par ses impôts, par son travail, par les économies faites sur les services publics, par l’augmentation des prix induite par les taxes sur les importations et la relocalisation de certaines fabrications. Il n’est nullement question de prendre sur les profits ni même de contraindre les capitalistes à quoi que ce soit.
Bien entendu, le premier effet de cette campagne mobilisant une bonne partie de la classe politique et médiatique américaine est la promesse d’un flot de subventions vers les chantiers navals et l’ensemble du secteur. Il y a aussi la volonté de pousser les grandes compagnies maritimes à entrer dans le jeu américain, comme on l’a vu avec MSC et CMA CGM, voire à les contraindre à abandonner une partie de leurs surprofits au bénéfice du capital étatsunien, quoique cela ne réglerait en rien la question de fond. Mais il faut aussi constater que l’État américain, et pas seulement Trump et quelques excités, envisage, prévoit et prépare un conflit avec la Chine, perspective qu’il juge inévitable pour maintenir sa position dominante. Pour l’impérialisme américain, il ne s’agit pas d’un choix parmi d’autres : c’est, ou plutôt cela peut devenir rapidement une question vitale.
Cette constatation met à leur juste place, insignifiante, les proclamations pacifistes de tout ordre, le battage médiatique européen sur « l’ogre russe », les prétentions nationales, les illusions réformistes de bonne ou de mauvaise foi. Elle montre que seule la lutte pour le renversement révolutionnaire du capitalisme est réaliste.
27 mars 2025