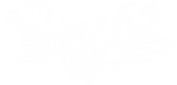Alors que la présence de l’impérialisme de seconde zone qu’est la France recule, l’image d’une Chine conquérante vise à faire serrer les rangs derrière l’État français. Toujours prompt à donner des leçons, Macron l’a formulé en 2021 à N’Djamena en déclarant : « Rien ne sert de restructurer les dettes africaines à l’égard de l’Europe et des États-Unis si c’est pour contracter à l’égard de la Chine. » Les États-Unis considèrent la Chine comme une rivale menaçant leur hégémonie qu’ils doivent contenir, et leur pression sur elle s’accroît partout y compris en Afrique.
Une présence forte de la Chine en Afrique
Les relations entre la Chine et l’Afrique sont anciennes. Sans remonter aux marchands chinois qui s’étaient aventurés sur la côte est du continent dès le 15e siècle, la visite en 1963 dans plusieurs pays africains de Zhou Enlai, Premier ministre de Mao, marqua les débuts d’une politique qui allait se traduire par l’envoi de techniciens agricoles et de personnel médical. L’État chinois maoïste, encore isolé par l’impérialisme, prétendait incarner une voie permettant aux pays pauvres de sortir du sous-développement. De grands travaux furent parfois menés, comme la construction de la ligne de chemin de fer Tazara (Tanzania-Zambia railroad) en 1973. Au moins 15 000 ouvriers vinrent de Chine pour poser les 1 860 kilomètres de voies reliant les gisements de cuivre de la Zambie au port de Dar-es-Salam en Tanzanie.
Mais ce n’est qu’à partir des années 2000 que les liens économiques entre la Chine et l’Afrique se sont vraiment développés. En vingt ans, leurs échanges commerciaux ont été multipliés par trente. Ils ont d’abord concerné des exportations chinoises de marchandises bon marché, des objets du quotidien en plastique, outils, bassines, bottes, des textiles,… Ces marchandises bon marché sont entrées en concurrence avec des biens manufacturés africains mais pas européens. Dans le textile, ce sont surtout le Nigeria ou le Ghana qui ont subi cette concurrence.
Depuis plusieurs années, des entreprises chinoises exportent aussi en Afrique des machines agricoles et des véhicules, petites voitures, autocars, motos, camions et engins de chantiers. Les succursales qui les vendent ne sont pas nécessairement chinoises : à Abidjan, ce marché est tenu par des concessionnaires libanais ou autres. Mais longtemps, l’Afrique francophone a été un marché protégé pour les entreprises françaises comme Peugeot ou Renault Trucks, dont le prédécesseur, Berliet, y écoulait déjà des camions à l’époque coloniale. Aujourd’hui, la concurrence est réelle entre les constructeurs, chinois comme Foton ou Sinotruck, allemand comme Daimler-Benz, italien comme Iveco.
Des infrastructures dérisoires, toujours conçues pour les exportations
En Afrique, les entreprises chinoises sont surtout omniprésentes dans le BTP. Mais malgré l’ampleur de certaines réalisations, les besoins élémentaires de la population ne sont absolument pas satisfaits. La production d’électricité de toute l’Afrique subsaharienne est ainsi équivalente à celle de l’Espagne. Au cœur du continent, une large partie du transport se fait par des moyens sommaires. Les rares chemins de fer, hérités de la colonisation, sont déliquescents et conçus pour l’exportation des matières premières.
Entre 2006 et 2017, la Chine a été au premier rang pour construire des infrastructures en Afrique, représentant près de 28 % des financements extérieurs, contre 6 % pour la France. La Chine a restauré des lignes : celle de Djibouti à Addis-Abeba en Éthiopie, et celle du Tazara doit bientôt l’être par la compagnie d’État chinoise CCECC. Le programme chinois des Nouvelles routes de la soie, lancé en 2013, concerne l’Afrique sur sa façade maritime est. Des infrastructures de transport de marchandises ont vu le jour, entre le canal de Suez, Djibouti et les ports de la côte est. Dans 21 ports africains sur 55, quatre grandes entreprises d’État chinoises opèrent en concurrence avec les géants européens MSC ou Maersk, et avec DP World qui appartient à l'émirat de Dubaï.
Certains dirigeants africains ont pu affirmer que les contrats avec la Chine, ses banques et ses entreprises, permettraient un développement économique. Passer des contrats avec la Chine ou la Russie, jouer entre différents concurrents, est pour eux une tentative de desserrer l’étau de l’impérialisme. Le passé de la Chine, dominée par les impérialistes pendant un siècle – même si elle n’a pas été formellement colonisée – lui permet de prétendre qu’avec elle, les accords économiques seraient « gagnant-gagnant ». Mais aucun contrat n’est gratuit et les États africains se sont endettés pour rembourser les prêts les finançant, prêts le plus souvent émis par une des deux grandes banques liées à l’État chinois, Exim Bank of China et China Development Bank. Vingt ans après les premiers contrats, les travaux facilitant l’exportation des matières premières africaines vers la Chine ont été achevés. Mais pour les infrastructures indispensables à la population, le bilan est bien modeste. Selon le ministère des Affaires étrangères chinois, 80 grandes centrales électriques, 130 hôpitaux et 45 stades auraient été construits pour toute l’Afrique en vingt ans, ainsi que 6 000 kilomètres de voies ferrées, à comparer aux 28 000 km du réseau ferré d’un pays comme la France. La Chine assure entre le quart et le tiers des travaux d’infrastructures en Afrique mais cela ne change rien au fait que le capitalisme condamne le continent au sous-développement.
La Chine dans le chaos engendré par l’impérialisme en Afrique
La Chine est devenue un partenaire commercial important du continent, représentant 16 % des importations africaines en 2022, contre 29 % pour l’Union européenne. Mais divisés et concurrents, chaque pays européen pris séparément pèse moins que la Chine seule, ce qui fait d’elle le premier partenaire commercial de l’Afrique. Mais le continent ne représente que 3 % du commerce extérieur chinois, à l’image, dans l’économie mondiale, de la place de ce continent où vit pourtant 18 % de l’humanité. Par contre, les importations de la Chine depuis l’Afrique sont substantielles. Elles concernent presque exclusivement des matières premières, des minerais, des métaux, des hydrocarbures, du bois, des fibres textiles et d’autres produits agricoles. L’Afrique a été intégrée depuis la fin du 19e siècle dans l’économie mondiale comme fournisseuse de matières premières pour les grandes puissances industrielles occidentales, la Chine a reproduit le même type de liens économiques avec l’Afrique.
Après les plans d’ajustement structurel des années 1980-1990, par lesquels le FMI et la Banque mondiale ont imposé des cures d’austérité violentes aux États africains, les entreprises occidentales ont délaissé un terrain insuffisamment rémunérateur à leurs yeux. La Chine, grâce au poids de son État et de ses entreprises publiques, a occupé cet espace vacant. Alors qu’elle devenait un sous-traitant essentiel des capitalistes occidentaux, la Chine a dû trouver les ressources nécessaires à son industrie. En Afrique, elle a noué des relations avec un certain nombre d’États afin d’assurer ses approvisionnements, en pétrole et en minerais. L’État chinois a protégé ses entreprises, qui ont trouvé une activité économique, maintenant à flot les infrastructures nécessaires à l’extraction des matières premières dont regorge l’Afrique. Investir dans des mines dans des régions isolées, bâtir et assurer la maintenance d’usines de raffinage de minerais, entretenir des routes ou des lignes de chemin de fer, demande des investissements considérables, et hasardeux, dans des pays instables politiquement. Bien des capitalistes européens ou américains préfèrent donc investir leurs capitaux ailleurs. Quand les prix des matières premières chutent, l’État chinois couvre les pertes de ses entreprises, leur permettant de survivre et de rester alors que les capitalistes occidentaux préfèrent trouver des marchés plus rémunérateurs.
Minerais : la ruée vers l’Afrique
Cuivre, cobalt, étain, tungstène, tantale… l’Afrique regorge des minerais indispensables aux productions électroniques, médicales ou militaires modernes. Leur extraction est soumise à une rude concurrence entre différentes entreprises, chinoises et occidentales. Sur le cobalt, longtemps leader, le géant anglo-suisse Glencore a récemment été détrôné par l’entreprise chinoise CMOC (China Molybdenum Company Limited). Mais l’enjeu n’est pas si déterminant qu’il y paraît car le marché du cobalt pour les batteries électriques est aujourd’hui saturé du fait du ralentissement du marché automobile en Chine et de la crise de l’économie mondiale. Les constructeurs automobiles s’orientent aussi davantage vers des batteries lithium-fer-phosphate, sans cobalt. Depuis 2022, le prix du cobalt a chuté de 75 %, ce qui a poussé en février 2025 le gouvernement congolais à suspendre les exportations. Il en espère une remontée des prix mais montre surtout son impuissance et sa dépendance à l’égard des marchés des matières premières. Ces marchés sont dominés par de grands trusts minéraliers, les anglo-australiens Rio Tinto et BHP Billiton, l’anglo-suisse Glencore et la sud-africaine Anglo-American. Quand les prix sont élevés, les matières premières enrichissent les capitalistes qui en contrôlent l’extraction, qu’ils soient chinois ou occidentaux. Mais que les prix chutent, et c’est la catastrophe pour les pays dont les revenus dépendent des exportations d’un nombre restreint de ressources naturelles. Ainsi, en suspendant les exportations de cobalt, les autorités congolaises ont précipité dans une misère encore plus profonde des milliers de mineurs artisanaux surexploités privés de travail.
Des commentateurs appellent cette calamité « malédiction des matières premières », comme si un dieu punissait les pays pauvres d’un supposé péché. Mais ce pillage n’est en rien une malédiction : il découle des échanges inégaux qui caractérisent le capitalisme. Les pays industrialisés puisent les matières premières dont ont besoin leurs firmes dans les sous-sols des pays pauvres. Dépourvus de production industrielle, ces derniers s’appauvrissent en important des biens manufacturés. La Chine prend sa part dans ces échanges inégaux mais dans une position subordonnée, dépendant elle-même des industriels américains ou européens.
Rivaux ou alliés… mais inégaux
Souvent présentées comme des rivales redoutables des compagnies européennes ou américaines, les entreprises chinoises interviennent dans de nombreux domaines en association avec de grands groupes occidentaux. En Ouganda, la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) exploite le pétrole du lac Albert avec le géant français Total. Sur ces projets, nommés Tilenga et EACOP, on trouve aussi des banques chinoises parmi les financeurs. Mais le vrai patron est Total, qui dicte sa loi à ses associés et l’impose aux États, fort de l’appui sans faille des autorités françaises.
Dans la téléphonie, l’entreprise privée Huawei a largement contribué à partir de la fin des années 1990 à construire les réseaux numériques africains, dans un secteur délaissé par les capitalistes occidentaux. Mais si elle est souvent accusée d’espionnage au profit des autorités chinoises par ses détracteurs européens et américains, Huawei assure en partie l’entretien des réseaux du français Orange, un des principaux opérateurs de téléphonie mobile et de paiements en Afrique.
Dans le BTP, bien des barrages hydroélectriques, ponts et routes sont construits par des groupes chinois avec la participation de compagnies occidentales. En Côte-d’Ivoire, la construction du barrage de Soubré, inauguré en 2017 et qui fournit 14 % de la production électrique de ce pays, a été menée par l’entreprise Sinohydro et majoritairement financé par Exim Bank of China mais les quatre turbines – parmi les pièces les plus technologiques, avec la plus grande valeur ajoutée – ont été construites par le français Alstom alors que la gestion environnementale du projet était assurée par Tractebel, une filiale du groupe Engie.
Pour les véhicules, une production dite « chinoise » peut cacher des liens avec des capitalistes occidentaux et la Chine occupe là encore une position sous-traitante pour le compte des impérialistes américain, japonais ou européen. Le constructeur chinois Foton vend en Afrique des camions sous licence Daimler-Benz, des véhicules « low cost » devenus invendables en Europe depuis des décennies. En Tunisie, Peugeot produit avec Dongfeng un pick-up dérivé d’un modèle ancien du japonais Nissan. Les constructeurs automobiles sont à la fois des concurrents, prêts à aller « manger dans la gamelle du voisin » selon l’expression de l’ancien PDG de Stellantis, et des alliés temporaires dans la guerre commerciale qu’ils se mènent.
La Chine, une puissance impérialiste en Afrique ?
Le terme « Chinafrique », cher aux défenseurs des intérêts de l’impérialisme français qui n’ont cessé de réfuter le terme « Françafrique », n’a pas de réalité. La Chine investit sur tout le continent mais, découpée en 54 pays, l’Afrique n’est pas homogène. La Chine n’a tissé de relations étroites, des accords d’État à État concentrant les contrats économiques, qu’avec un nombre réduit de pays : l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, la RDC, l’Égypte, le Nigeria et le Soudan. Surtout, la Chine n’y a aucun héritage colonial et ses investissements y sont très modestes. Mais certains, y compris à l’extrême gauche, parlent d’un nouvel impérialisme chinois, en voulant pour preuve les Nouvelles routes de la soie, le poids économique de la Chine dans les ports ou les mines, les dettes d’États qu’elle détient1.
La Chine a bien ouvert dans différents pays africains des zones économiques détaxées, pour favoriser l’implantation de capitaux chinois, mais avec un succès limité. Les lignes de chemin de fer qu’elle a financées s’avèrent bien souvent peu rentables voire déficitaires, comme la ligne d’Addis-Abeba à Djibouti. Des employés chinois des entreprises d’État sont restés en Afrique, ont ouvert des commerces ou fait venir leur famille paysanne pour fonder des élevages intensifs de porcs ou de poules, qui se vendent plus cher qu’en Chine. Dans certains pays, les producteurs locaux d’œufs ou de poulets ont été évincés par les fermes plus productives tenues par des Chinois. Mais dans la guerre économique mondiale, le poulet ne pèse pas lourd.
Jusqu’en 2016, les quatre grandes banques chinoises, liées à l’État, ont prêté d’importantes sommes à des États africains. Mais ces prêts ont depuis énormément diminué, à cause des incertitudes sur leur remboursement mais aussi à cause des difficultés de l’économie chinoise elle-même. La Chine ne détient aujourd’hui que 8 % de la dette publique africaine alors que des financiers privés en possèdent 60 %. Ces vautours sont surtout des fonds occidentaux, les banquiers américains Citigroup, JPMorgan, Bank of America, le fonds BlackRock, la banque britannique Barclays, l’assureur allemand Allianz, le Crédit Agricole, BNP-Paribas et la Société Générale.
Dans L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, Lénine faisait de l’exportation des capitaux un trait fondamental de l’impérialisme. Sur ce point, les investissements directs en Afrique venus de la Chine sont bien plus limités que ne le prétend la propagande des défenseurs des impérialistes occidentaux. En 2021, ces investissements venus de Chine arrivaient en cinquième position, derrière les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ils ont représenté cette année un montant de 4,9 milliards de dollars pour toute l’Afrique, l’équivalent des investissements du groupe américain Pepsi pour le seul Mexique. Derrière la modestie du montant, il y a aussi une différence qualitative. Les capitaux occidentaux sont surtout ceux d’entreprises privées, pouvant aller et venir librement. Les capitaux venant de Chine appartiennent essentiellement aux grandes entreprises liées à l’État central ou aux gouvernements des provinces chinoises. Si ces compagnies chinoises peuvent s’asseoir à la table des brigands, c’est grâce à la tutelle de leur État, puissant et centralisé, mais elles ne jouent pas dans la même catégorie que leurs concurrents capitalistes occidentaux.
Les États-Unis mettent la pression sur la Chine
Mais alors que la crise s’exacerbe, que la guerre économique se tend, la pression des États-Unis sur la Chine s’accroît aussi sur le continent africain. Le contrôle de l’extraction et du transport des métaux, trop dominé par la Chine aux yeux des impérialistes, est devenu l’enjeu de rivalités. L’Europe, divisée en une multitude de bourgeoisies et d’États concurrents, n’a pas la taille suffisante face au poids économique de la Chine. Les États-Unis, eux, ont les moyens de défendre leurs intérêts et n’hésitent pas à intervenir s’ils le jugent nécessaire.
En Angola, sous prétexte d’accélérer et de sécuriser le transport des minerais, les États-Unis ont investi dans le « corridor de Lobito », une vieille ligne de chemin de fer qui relie le port angolais de Lobito au Katanga au sud de la RDC. Fin 2024, Joe Biden a visité Lobito et annoncé 500 millions de dollars de plus, sur un investissement total de 1,6 milliard. Le consortium chinois qui postulait pour les travaux a été écarté au profit d’un autre, mené par le négociant suisse Trafigura, qui est impliqué dans plusieurs scandales de corruption. Ces détails n’ont pas empêché Joe Biden de dénoncer la présence de la Chine en Afrique, affirmant qu’elle y aurait un « programme d’endettement et de confiscation ». Venant de la puissance impérialiste dominante, c’est vraiment l’hôpital qui se moque de la charité.
Depuis deux décennies, si la Chine a bien pris en main des travaux d’infrastructure, indispensables aux exportations des ressources naturelles du continent, et prêté aux États africains que les financiers occidentaux avaient mis à genoux, elle est loin d’être l’usurier impitoyable évoqué par Biden. Dans l’économie mondiale, la Chine joue un rôle de sous-traitant et elle n’a pas les mêmes armes que les puissances impérialistes pour défendre les intérêts de ses entreprises, essentiellement étatiques et non privées comme le grand capital occidental. Un autre indicateur, déterminant, qui montre que la Chine n’est pas une puissance impérialiste, est son poids militaire limité en Afrique.
Impérialisme et présence militaire
Bien que nombreuse et équipée, l’armée chinoise est incapable de se projeter en Afrique, d’assurer la formation de militaires ou d’appuyer des régimes alliés, comme la France l’a fait pendant des décennies dans son ancien empire colonial, et comme le font partout les États-Unis.
Depuis 2017, elle dispose d’une base à Djibouti, qui a surtout un rôle logistique, en particulier pour les opérations dites de « maintien de la paix » de l’ONU. L’armée chinoise fournit des Casques bleus : en 2023, elle déployait 1 852 hommes en Afrique, au Mali, au Sud-Soudan, au Darfour, en RDC et en Centrafrique. C’est bien loin des 6 000 soldats américains opérant en Afrique sous le contrôle d’Africom, le commandement militaire de l’armée américaine pour l’Afrique, auxquels s’ajoutent 4 000 hommes stationnés dans la base militaire américaine de Djibouti, voisine de la très ancienne base française qui compte 1 450 hommes. Africom, qui occupe 29 sites dans 15 pays africains, emploierait au moins autant de mercenaires de sociétés militaires privées, qui agissent en toute discrétion pour défendre les intérêts de l’impérialisme américain. Pour la Chine, il n’y a rien de tout cela.
Ce sont toujours la France et la Grande-Bretagne, et de plus en plus les États-Unis, qui assurent l’essentiel de la formation des officiers des armées africaines. Ces relations montrent leur dépendance à l’encontre des puissances impérialistes, à commencer par les États-Unis, qui organisent chaque année des exercices militaires pendant lesquels leurs officiers et ceux des armées africaines établissent des liens. Exporter des capitaux, manier le bâton pour étendre son influence, saper celle de ses concurrents, avoir des relais dans tous les pays, c’est aussi cela qui caractérise la domination impérialiste. Sur tous ces terrains, la Chine en est bien loin.
Venus de Chine ou d’ailleurs, les patrons restent des exploiteurs
Sans appartenir à un impérialisme, les entreprises chinoises ne sont pas en reste en matière d’exploitation de la classe ouvrière. Si, jusqu’en 2016, elles faisaient le plus souvent venir de Chine leur personnel, dont des ouvriers qualifiés, elles embauchent de plus en plus des travailleurs africains. Leur position de sous-traitant, dans des secteurs souvent moins rentables, les pousse à des méthodes brutales. En Côte-d’Ivoire, dans le BTP, un coffreur qualifié travaillant dans une filiale du Français Bouygues peut gagner 12 000 francs CFA par jour, alors que dans les entreprises chinoises, le salaire ouvrier oscille autour de 4 000 francs par jour, parfois moins, soit environ 6 euros par jour. Pour arriver à gagner un peu plus, 7 000 à 8 000 francs, il faut faire beaucoup d’heures supplémentaires, travailler tous les jours. À ces conditions, les entreprises chinoises n’ont guère la cote auprès des travailleurs, mais il n’y a pas nécessairement de sentiment antichinois pour autant. Dans les entreprises chinoises, les patrons font encore venir de Chine leurs petits chefs, sans qu’ils soient pour autant des privilégiés. Ils vivent chichement et travaillent des heures et des heures, bien loin des conditions aisées des cadres européens « expatriés » qui disposent d’une voiture, de loisirs et de personnel de maison.
Derrière les patrons chinois, on trouve parmi les premiers profiteurs les cabinets d’étude européens, les grandes banques occidentales ou les trusts comme le Français CMA CGM ou l’Italo-Suisse MSC, qui contrôlent le trafic de conteneurs et les ports. Les patrons chinois sont plus visibles puisque leurs petits chefs jouent le rôle de gardes-chiourmes pour exploiter les travailleurs. Parfois, en faisant grève, les ouvriers parviennent à obtenir quelques augmentations de salaire ou quelques protections de sécurité.
Dans leur journal Le Pouvoir aux travailleurs de décembre 2024, nos camarades de l’UATCI (UCI) relatent une grève sur un chantier routier réalisé par Sinohydro, qui compte 300 ouvriers. Un gréviste témoigne : « Nous effectuons 10 heures de travail par jour, sept jours sur sept, pour un salaire de misère. Nous nous sommes organisés pour revendiquer 3 000 francs CFA d’augmentation par jour pour tous […]. Le jeudi 9 janvier au petit matin, les piquets de grève ont commencé à sillonner le chantier pour entraîner le maximum de nos camarades. Aux environs de 10 heures, tout le chantier a été paralysé […]. Comme notre mouvement a été bien suivi, la direction a été contrainte de recevoir une délégation de grévistes et a promis un premier paiement à partir du 20 janvier. C’est dans cette ambiance que nous avons repris le travail le lendemain matin après un bref meeting pour décider de la suite à donner au mouvement dans le cas où rien ne serait fait à la date du 20 janvier. Nous ne sommes pas dupes. Nous avons affaire à des capitalistes, ces gens-là ne comprennent que le langage de la force. »
Ne pas tomber dans le piège de l’unité nationale, en Afrique comme en Europe
Les capitalistes et les dirigeants chinois ne peuvent évidemment être considérés comme des alliés des exploités d’Afrique, pas plus que les bureaucrates et les oligarques russes emmenés par Poutine. Des dirigeants africains comme les militaires à la tête du Mali ou du Burkina Faso peuvent chercher auprès d’eux des appuis pour desserrer un peu l’étreinte impérialiste. Mais, prêts à écraser la moindre contestation, la moindre grève, et formés pour cela dans les écoles militaires occidentales, ils ne peuvent représenter les intérêts des masses pauvres ni être pour elles un appui. Quant à la propagande qui est menée en France contre la « Chinafrique » ou la présence russe en Afrique, elle ne vaut évidemment pas mieux. Elle vise à préparer les futures interventions impérialistes, sous couvert de défense de la démocratie, en réalité pour les intérêts de groupes comme Total. En Afrique subsaharienne et au Maghreb, de nombreux ouvriers chinois sont présents, et même si leur sort peut sembler un peu plus enviable que celui de leurs frères d’Afrique, tous appartiennent à la même classe ouvrière. Elle représente l’avenir, tout comme elle le représente dans les citadelles de l’impérialisme mondial.
28 mars 2025
1 « La Chine, nouvel impérialisme émergé », L’Anticapitaliste, novembre 2021.