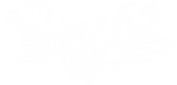États-Unis-Russie : des rapports entre brigands
Le rapprochement américano-russe et l’ouverture de discussions officielles entre des représentants des deux pays ont pu en surprendre beaucoup. Pourtant, depuis trois ans les discussions en coulisse n’ont jamais cessé, pas plus que les calculs des dirigeants de l’appareil d’État américain sur l’opportunité ou non de faire durer le conflit russo-ukrainien. En février 2024, le directeur de la CIA, William J. Burns, écrivait que cette guerre était « un investissement relativement modeste avec des retombées géopolitiques importantes pour les États-Unis et des retombées notables pour l’industrie américaine ». Il avait ajouté « en attendant qu’une opportunité de négociations sérieuses se présente ». Aujourd’hui Trump et son équipe, qui ne pourraient agir sans le consentement, sinon l’assentiment, des hautes sphères de l’appareil d’État semblent estimer que le moment serait favorable.
Les destructions massives, les centaines de milliers de victimes ukrainiennes et russes, ne pèsent pour rien dans cette décision. Sur le champ de bataille, l’armée russe grignote des territoires ukrainiens, au prix de milliers de morts de chaque côté du front. Quant à la population ukrainienne, elle est de plus en plus hostile à cette boucherie dont elle est la première victime et qui a créé un fossé de sang entre deux peuples reliés par des siècles d’histoire commune. Pour les dirigeants américains, cette guerre a maintenant apporté aux États-Unis l’essentiel de ce qu’ils pouvaient en attendre. Outre les « retombées notables » pour leurs marchands d’armes, cette guerre a affaibli la Russie, ce qui était l’un des objectifs, mais aussi, de façon différente, les puissances européennes concurrentes des États-Unis, à commencer par l’Allemagne, privée du gaz russe, et dont l’économie est en récession depuis plusieurs trimestres.
Pour les capitalistes américains, il semble que le moment soit venu de solder les comptes en poussant à la fin des combats pour pouvoir exploiter les ressources minérales, les riches terres agricoles et les infrastructures de l’Ukraine sur lesquelles ils ont déjà mis la main. De son côté, Poutine a fait des offres de collaboration en invitant ceux qu’il appelle de nouveau ses « partenaires américains » à venir exploiter les terres rares en Russie.
En envahissant l’Ukraine, Poutine voulait montrer aux pays de l’Otan qu’il n’accepterait pas davantage leurs pressions et leur mainmise sur des pays issus de l’éclatement de l’Union soviétique. Il s’est heurté à un État ukrainien sous perfusion de ses protecteurs occidentaux depuis des décennies et de façon intensifiée ces trois dernières années, un État qui a résisté avec un coût humain et économique que les Ukrainiens paieront pendant des décennies. Mais Poutine, lui aussi au prix des sacrifices multiples imposés à sa propre population, a pu maintenir son pouvoir.
La guerre en Ukraine n’est que l’un des nombreux points chauds engendrés sur le globe par la lutte permanente de l’impérialisme pour la suprématie mondiale alors que la crise économique ne cesse de s’aggraver. Face à l’instabilité permanente qui règne dans de nombreuses régions, les dirigeants américains auraient tout avantage à associer la Russie au maintien de l’ordre impérialiste et à lui faire cautionner leurs choix. C’est en particulier le cas au Moyen-Orient où la donne a été modifiée au cours de l’année écoulée sous les coups de l’armée israélienne. Il est également probable que les États-Unis cherchent à dissocier la Russie de la Chine et, en se rapprochant de la première, essayent d’isoler la seconde.
Cette collaboration ouverte pour faire régner l’ordre mondial, celui du capitalisme, n’aurait rien d’une nouveauté. Depuis le pacte Laval-Staline signé en 1935, les dirigeants des puissances impérialistes d’un côté, et de l’autre les bureaucrates à la tête de l’Union soviétique, de Staline à Brejnev, ont su s’entendre pour défendre l’ordre impérialiste. Chacun dans leur zone, parfois en collaboration, ils ont maté les révolutions ou les révoltes populaires, affaibli ou abattu les régimes pas assez soumis à leurs yeux. L’époque a changé, l’Union soviétique a disparu, et Poutine, qui défend les intérêts des bureaucrates et des oligarques russes, peut encore plus facilement que ses prédécesseurs s’entendre avec Trump ou d’autres dirigeants de l’impérialisme.
L’Europe divisée et de nouveau mise à la portion congrue
Le changement de pied américain n’est donc pas « un renversement d’alliance inédit » (Le Drian). Si les dirigeants européens s’offusquent, c’est qu’ils ont été traités par Trump avec le mépris qu’eux-mêmes réservent habituellement aux chefs d’État des pays pauvres. S’ils s’indignent aujourd’hui parce que les brigands Trump et Poutine se réconcilient pour se partager les richesses de l’Ukraine, s’ils s’agitent pour rester dans le jeu, s’ils augmentent leurs budgets militaires, c’est parce qu’ils redoutent d’être privés de l’accès aux précieux minerais, aux riches terres agricoles et au marché de la reconstruction d’un pays détruit. Sébastien Lecornu, ministre des Armées français, l’a reconnu le 27 février sur France Info : le gouvernement français négociait depuis des mois avec l’Ukraine pour avoir lui aussi sa part de métaux stratégiques que sont les terres rares.
Il faut l’hypocrisie des dirigeants des pays européens et la servilité de classe des médias pour faire semblant de découvrir que les relations entre ceux-ci et les États-Unis ne sont rien d’autre que des relations entre puissances inégales luttant sans pitié pour accaparer les marchés. Il y a cent ans, analysant les rapports de force politiques et économiques entre l’Amérique et une Europe morcelée et affaiblie à la sortie de la Première Guerre mondiale, Trotsky écrivait : « Que veut le capital américain ? À quoi tend-il ? […] En un mot, il veut réduire l’Europe capitaliste à la portion congrue, autrement dit lui indiquer combien de tonnes, de litres ou de kilogrammes de telle ou telle matière elle a le droit d’acheter ou de vendre. »1 Cent ans plus tard, après une deuxième guerre mondiale, des décennies d’une construction européenne inachevée et inachevable, l’éclatement de l’Union soviétique et la mise en coupe réglée des pays d’Europe de l’Est par les capitalistes de l’Ouest, le déséquilibre des rapports de force entre les États-Unis et l’Europe s’est accru. Les divergences d’intérêts entre les États se sont même aggravées au fur et à mesure que la crise de l’économie exacerbait la concurrence entre les capitalistes.
La faiblesse congénitale des bourgeoisies d’Europe, jamais surmontée, vient de ce qu’elles ont émergé de la féodalité en s’appuyant sur des marchés puis des États concurrents, dans des cadres nationaux devenus très vite trop étroits. Face au puissant impérialisme américain, il n’y a pas un impérialisme européen unique, avec un appareil d’État unique défendant les intérêts fondamentaux d’une seule grande bourgeoisie européenne. Il y a des impérialismes européens concurrents, représentant des capitalistes nationaux, aux intérêts économiques parfois communs mais souvent opposés.
La guerre en Ukraine a renforcé ces antagonismes entre pays européens en même temps qu’elle a dégradé la compétitivité des pays européens par rapport à celle des États-Unis, ne serait-ce qu’à cause du fort renchérissement du prix de l’énergie en Europe. Ainsi, selon la direction générale du Trésor, la production manufacturière a reculé dans plusieurs pays européens depuis 2022, en particulier en Allemagne (– 6,7 %) et en Italie (– 5,7 %), du fait de la baisse de la production dans la chimie, la pharmacie et l’automobile2. L’ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, l’avait formulé en septembre 2024 dans un rapport sur la compétitivité européenne où il s’alarmait que l’Union européenne soit confrontée à un « défi existentiel » face aux États-Unis et menacée d’une « lente agonie » faute d’investissements massifs dans des infrastructures, la recherche et des moyens de production renouvelés.
Draghi réclamait « un choc d’investissement » de 800 milliards d’euros en Europe et en appelait aux investisseurs privés. Mais les capitalistes, ceux d’Europe comme d’ailleurs, n’ont pas de patrie. Ils investissent leurs capitaux là où ils le décident, c’est-à-dire là où ils espèrent le plus grand profit. Bien avant le retour de Trump à la Maison-Blanche et ses annonces sur des droits de douane à 25, 50 voire 200 %, Biden avait intensifié le protectionnisme des États-Unis, avec des moyens bien plus considérables que les États européens. Son Inflation Reduction Act (IRA) a déversé des milliards de subventions sur les capitalistes qui se sont installés aux États-Unis. Attirés par cette manne et par des prix de l’énergie trois fois plus faibles, des groupes européens, dans la chimie, l’industrie automobile, la fabrication de batteries, ont transféré une partie de leur production de l’autre côté de l’Atlantique. Le 6 mars, au moment même où Macron en appelait au patriotisme pour faire face au lâchage du grand allié américain, Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM, qui doit son développement et sa fortune aux largesses de l’État français, se faisait inviter à la Maison-Blanche pour promettre à Trump 20 milliards de dollars d’investissements aux États-Unis et la création de 10 000 emplois. Et tout le monde se souvient du chantage du multimilliardaire Bernard Arnault, invité à l’investiture de Trump, menaçant de délocaliser ses entreprises si le gouvernement français augmentait leurs impôts. Le seul drapeau des capitalistes est le profit.
Dans la guerre économique mondiale, il n’y a pas une politique européenne mais des États nationaux qui agissent en fonction des intérêts de leurs capitalistes, et d’abord de ceux qui pèsent le plus sur ces États. Ainsi quand l’Union européenne a imposé, le 30 octobre dernier, des taxes supplémentaires (jusqu’à 35 % !) sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, l’Allemagne a voté contre pour préserver les intérêts de ses constructeurs qui exportent beaucoup dans ce pays. Lors des dernières discussions sur le traité du Mercosur, la France était contre sa ratification au nom de la protection de « ses » agriculteurs quand l’Allemagne la souhaitait pour aider ses constructeurs à vendre des automobiles au Brésil ou en Argentine. Le 27 mars, Trump a annoncé une nouvelle taxe de 25 % sur tous les véhicules produits à l’étranger et importés aux États-Unis. Elle risque de frapper surtout les constructeurs allemands qui exportent aux États-Unis chaque année 450 000 véhicules haut de gamme, pour un montant de 24 milliards de dollars. On peut parier que le front européen face aux taxes américaines, voulu par Macron et Merz, se réduira au plus petit dénominateur commun entre les capitalistes allemands et français.
En revanche, dans chaque pays, la guerre économique intensifiée par l’administration Trump sert de prétexte pour imposer des gains de productivité à tous les travailleurs et de nouveaux sacrifices aux classes populaires. Cette guerre-là ne tue pas directement, mais elle a déjà supprimé des emplois par centaines de milliers et plonge des villes et des régions dans la désolation par des fermetures d’usines. Les subventions étatiques versées pour mener cette guerre engloutissent des centaines de milliards d’euros qui manquent aux hôpitaux ou aux écoles.
« Économie de guerre », jackpot pour les marchands d’armes
Cette guerre de classe va s’intensifier avec le passage à « l’économie de guerre » voulue par les dirigeants européens. Cherchant à effrayer en agitant « la menace russe qui touche tous les pays d’Europe » et en affirmant que « la paix ne peut pas être garantie sur notre territoire », Macron, qui a retrouvé un peu d’oxygène politique en endossant le costume de chef de guerre, veut doubler le budget militaire français en cinq ans. Dans toute l’Europe, la prétendue menace russe et la brutalité du revirement américain en Ukraine sont utilisées pour justifier l’augmentation des budgets militaires, mettre la population en condition pour lui faire accepter de nouveaux sacrifices et la préparer à faire les frais d’un conflit, de plus en plus présenté comme inévitable.
En Allemagne, avant même d’être investi, Friedrich Merz, le prochain chancelier, a fait modifier la loi constitutionnelle pour lever « le frein à l’endettement » et lui permettre de dépenser des centaines de milliards d’euros pour l’armée. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a autorisé les États membres à dépenser jusqu’à 800 milliards d’euros pour « réarmer l’Europe ».
Mais les États européens ne pèseront pas plus dans les discussions autour d’une hypothétique paix en Ukraine qu’ils n’ont pesé dans le prolongement de la guerre. L’envoi en Ukraine d’une « force de réassurance », comme le proposent Macron et Starmer, le Premier ministre de Grande-Bretagne, est conditionné à un accord entre Trump et Poutine sur un cessez-le-feu et à leur double acceptation que les Européens viennent jouer les Casques bleus. Derrière leurs rodomontades, les dirigeants européens savent qui est le maître : traités comme des paillassons par Trump, ils ne cessent de rendre hommage à « notre allié américain » sans lequel ils sont impuissants faute de disposer, par exemple, d’assez de satellites.
Pour prendre en compte le possible retrait de la protection militaire américaine, les dirigeants européens parlent de bâtir une « Europe de la défense », réactivant une vieille lune de l’époque de la guerre froide. Mais pas plus aujourd’hui qu’hier, il ne peut y avoir une défense européenne car il n’y a pas d’État européen. Les États peuvent engager des actions militaires communes, se retrouver unis de façon temporaire, mais cette unité disparaît dès que les rapports de force qui ont servi de base à ces accords se modifient. Leurs intérêts et leurs priorités sont rarement les mêmes, des pays comme la Pologne et les États baltes estimant par exemple vital de rester sous la protection américaine.
Les divergences commencent bien avant le champ de bataille, dès les commandes d’armement pour lesquelles chaque État protège les intérêts de ses marchands de mort respectifs. Dassault doit sa fortune au soutien indéfectible de l’État français depuis un siècle, et, pour la période récente, à la capacité des gouvernements français de lui acheter ses avions Rafale ou d’en faire la promotion auprès des dirigeants indiens, égyptiens ou des rois du pétrole du Golfe. Il est significatif que ni la Grande-Bretagne ni l’Allemagne ne possèdent le moindre avion Dassault, de même que l’armée française n’a jamais acheté de chars Leopard construits par la firme allemande Rheinmetall.
Plus significatif encore de leurs relations de subordination envers les États-Unis, 64 % des armes importées par des pays européens membres de l’Otan depuis le début de la guerre en Ukraine ont été achetés à des industriels américains, Lockheed Martin, Boeing et autres Northrop. Pour faire mine de réduire cette proportion, le plan de la Commission européenne, appelé SAFE, impose que les armes achetées grâce aux emprunts garantis par l’UE, jusqu’à 150 milliards d’euros, comportent au moins 65 % de composants produits en Europe. Il s’agit surtout d’un effet d’annonce car la plupart des commandes d’armement se font sans recourir à ce type d’emprunt.
Pour l’heure, le renforcement de la « défense de l’Europe » et l’annonce, déjà faite en 2022, de la mise en place d’une « économie de guerre » sont d’abord un immense plan de relance économique qui profitera à une myriade d’industriels et de financiers. C’est une manne pour les marchands d’armes, qu’ils soient européens ou pas. Le PDG de Thales, qui produit des systèmes de radars et qui a déjà engrangé un record de 2,4 milliards d’euros de profits en 2024, envisage « une décennie de croissance et peut-être plus » (Les Échos du 4 mars 2025). Depuis ces annonces, les cours des actions de toutes les industries liées à l’armement se sont envolés.
Mise en condition et guerre de classe
Cette agitation autour de la prétendue menace russe et de la nécessité qu’elle impliquerait de relancer l’industrie d’armement pour se défendre n’est pas seulement destinée à arroser les marchands d’armes.
Elle sert à imposer des sacrifices à la population et à aggraver l’exploitation des travailleurs. « Nous ne pourrons plus toucher les dividendes de la paix » ; « On va devoir revisiter nos priorités nationales » ; « Il faudra des réformes, des choix, du courage » : le message de Macron, relayé matin, midi, et soir par les dirigeants politiques, les porte-parole patronaux et la meute de journalistes aux ordres est sans ambiguïté : les milliards supplémentaires pour les bombes, les drones ou les Rafale seront pris sur les logements sociaux, les écoles, les hôpitaux… Le passage à l’économie de guerre justifiera de rallonger le temps de travail, de reporter l’âge de départ à la retraite, de supprimer des jours de congé.
Ce climat guerrier sert à préparer la population et la jeunesse à accepter des sacrifices et des privations aujourd’hui, à accepter de souffrir et de mourir dans les tranchées demain. Car la guerre est inscrite dans l’aggravation des contradictions d’une économie capitaliste sénile, dans l’intensification des rivalités entre les capitalistes et les puissances qui défendent leurs intérêts, pour contrôler les matières premières, gagner des marchés, affaiblir ou couler les concurrents. La guerre fait rage au Moyen-Orient. Elle ensanglante des pays africains, à commencer par la République Démocratique du Congo et le Soudan. Qui oserait parier que la rivalité entre les États-Unis et la Chine ne se transformera pas, tôt ou tard, en une guerre ouverte ? Et comment évoluera la guerre commerciale entre les États-Unis et l’Europe ? Que se passera-t-il si les États-Unis annexent le Groenland administré par le Danemark ? Il est impossible de prédire quel affrontement peut finir en conflagration militaire générale. Ces guerres impérialistes pour la domination du monde ne seront pas celles des travailleurs. Elles serviront au contraire à défendre et renforcer les intérêts de ceux qui les exploitent.
Avant même qu’il n’y ait la guerre, tous les partis qui se disputent le droit de servir les intérêts de la bourgeoisie réalisent l’union nationale. Même ceux qui tiennent à se distinguer de Macron se mettent au garde-à-vous devant les chefs de l’armée. LFI s’est réjouie du non-alignement derrière les États-Unis ; le PCF réclame une industrie militaire et une armée purement françaises ; tandis que les écologistes et les socialistes invoquent la défense « des valeurs humanistes et démocratiques européennes » pour coiffer le casque lourd. Quant aux dirigeants du RN, s’ils réclament la paix en Ukraine et refusent une défense européenne, ils applaudissent à l’augmentation du budget militaire pour « renforcer la souveraineté nationale ». De leur côté, les directions des syndicats se sont, elles aussi, ralliées à la nécessité d’une économie de guerre. Pour Marylise Léon de la CFDT, « le contexte international est préoccupant. On n’est pas entré en guerre, mais c’est un appel à la responsabilité ». Quant à Sophie Binet, de la CGT, elle ne rate pas une occasion de défendre la souveraineté nationale : « On ne peut pas nous parler matin, midi et soir d’économie de guerre et laisser mourir notre industrie. »
Tous ceux, dirigeants syndicaux ou chefs de parti, qui n’ont que la « souveraineté nationale » à la bouche masquent le fait que dans cette nation, il y a des exploiteurs et des exploités, des capitalistes dont le patriotisme consiste à mettre les moyens de l’État à leur disposition pour augmenter leurs profits et des travailleurs qui produisent tout et font marcher toute la société. Par deux fois au 20e siècle, les seconds ont été envoyés mourir sur les champs de bataille pour garantir les profits des premiers, lors des guerres mondiales. Les capitalistes et leurs serviteurs politiques n’auront aucun scrupule à recommencer et ils s’y préparent activement.
S’opposer à l’avenir sanglant que le capitalisme nous prépare commence par refuser l’embrigadement derrière nos dirigeants et le drapeau national, par dénoncer le fait que les écoles et les hôpitaux soient sacrifiés pour financer des bombes ou des canons, par exiger la réquisition des profits des marchands d’armes. Mais il n’y aura pas de paix tant que les travailleurs n’auront pas renversé la dictature des capitalistes.
31 mars 2025
1« Des perspectives de l’évolution mondiale », discours prononcé par Léon Trotsky le 28 juillet 1924.
2Marion Bachelet et Léocadie Darpas, « Flash Conjoncture Pays avancés –Une baisse marquée de la production industrielle en Allemagne et en Italie depuis 2023 », sur le site de la direction générale du Trésor, 21 janvier 2025.