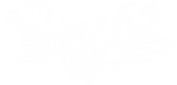Tête-à-Tête russo-américain
Le fait le plus notable dans les propos de Trump, ce sont les conditions dans lesquelles pourraient se tenir des négociations, pas le fait qu’elles aient lieu. En effet, les belligérants ont mené des pourparlers dès le début de « l’opération spéciale » de Poutine. À Istanbul, en avril 2022, ils avaient même accouché d’un projet d’accord, qu’en définitive Zelensky rejeta. Il se voulait soutenu « jusqu’à la victoire » par le camp occidental et signa alors un décret interdisant qu’un représentant de l’État ukrainien négocie avec le Kremlin.
Le voici en quelque sorte exaucé : c’est sans lui que se jouera le sort de l’Ukraine, ainsi en ont décidé Trump et Poutine. Quant aux alliés de Washington dans l’OTAN, ils se retrouvent eux aussi hors-jeu. Quel besoin auraient les chefs des États américain et russe, dont la rivalité d’intérêts dans le pillage de l’Ukraine a plongé ce pays et ses habitants dans l’horreur, d’associer à leurs tractations ces seconds couteaux que sont l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ? Dans un second temps, piètre lot de consolation, on leur fera peut-être une petite place quand il s’agira de décider combien de militaires européens auront la charge de « garantir la paix », et en fait les intérêts des grands groupes occidentaux, surtout américains, dans l’Ukraine restée sous l’autorité de Kiev. Car si l’Ukraine figure quand même à la table des deux compères, c’est en tant que gâteau qu’ils entendent se partager.
Trump ou l’impérialisme sans fard
Le temps n’est plus aux hypocrites tirades des gouvernants et médias occidentaux sur la défense de la « démocratie » en Ukraine. Il a disparu de la presse et des discours, le droit de ce « petit pays » à choisir son avenir, qu’invoquaient certains pour se ranger dans le « camp de l’Ukraine », malgré le rôle majeur de l’impérialisme dans cette guerre et ses causes. Il ne subsiste que la réalité des rapports de force. C’est la loi du plus fort. Et c’est elle qui donne à deux grandes puissances le droit de décider de l’avenir de l’Ukraine. Les dirigeants ukrainiens s’indignent qu’on ne fasse même pas mine de les consulter ? C’en serait risible s’ils avaient jamais permis à leur population d’avoir voix au chapitre, dans cette guerre comme avant.
Les dernières semaines ont asséné de la façon la plus brutale une claire leçon de politique. Sur cet ordre mondial dont se gargarisent les médias, et que les grandes puissances façonnent au gré de leurs intérêts et des changements de rapports de force entre elles. Sur le cynisme de classe des dirigeants de la principale puissance impérialiste qui, après avoir poussé l’Ukraine comme leur pion contre la Russie en l’assurant d’un soutien « indéfectible » –une position constante depuis l’effondrement de l’URSS en 1991–, acceptent son démantèlement en disant « irréaliste » qu’elle retrouve ses frontières de 2014. Ou encore quand Trump, en prélude aux marchandages avec Poutine, fait les poches de son ex-protégé Zelensky. Il a exigé qu’il cède aux capitalistes américains 500 milliards de dollars, ramenés à 375 milliards, de ressources stratégiques, de l’uranium aux terres rares, pour dédommager les États-Unis du soutien militaire et financier qu’ils ont fourni à Kiev. Un soutien qui, selon les sources, ne dépasse pas 175 milliards de dollars.
Accord de paix ou pas, les États-Unis sont déjà les grands vainqueurs de cette guerre. Et pas seulement parce qu’ils en ont déjà tiré d’immenses avantages matériels et financiers. Cette guerre, qu’ils ont menée avec la peau des Ukrainiens, a servi de vitrine de promotion géante aux armements made in USA, dont elle a dopé les ventes, notamment dans l’Union européenne (UE). Westinghouse a mis la main sur le secteur nucléaire en Ukraine, des financiers américains, mais aussi européens, ont accaparé ses très fertiles terres noires. Il y a aussi les contrecoups des sanctions que Washington impose à Moscou depuis 2014. Si elles ont affaibli la Russie malgré la capacité de résilience de son économie, héritage de la période soviétique, elles ont porté des coups sévères à l’économie des États de l’UE, alliés et concurrents des États-Unis. Elles ont affecté leur présence en Russie, le commerce bilatéral avec ce pays, leur approvisionnement en hydrocarbures, les ont forcés à remplacer le gaz russe par du GNL américain bien plus coûteux – ce dont a pâti surtout l’Allemagne, dont une partie de l’industrie dépendait du gaz russe.
Quant aux discussions russo-américaines, dont on ne sait pas grand-chose, une chose est sûre : elles ne présagent pas d’un arrêt des combats à court terme. Au contraire, chaque camp va s’efforcer, au prix de pertes et destructions accrues, de renforcer ses positions sur le terrain. L’un, le Kremlin, pour négocier en ayant un maximum d’atouts en main, l’autre, le pouvoir de Zelensky, pour ne pas trop devoir céder… à son « protecteur » américain.
Ce qui transpire dans la presse des points sur lesquels Trump et Poutine paraissent s’entendre (l’amputation de l’Ukraine de territoires tenus par la Russie, mais lesquels ? la non-adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, mais pour combien de temps ? la non-entrée dans l’UE) ne dit rien des conditions concrètes d’un éventuel accord en ces domaines. Restent tous les sujets où les intérêts des parties s’opposent. Ainsi, la bureaucratie russe et ses oligarques exigeront la levée des sanctions occidentales pour retrouver la liberté de vendre leurs hydrocarbures, dont ils tirent près de la moitié de leurs revenus. Or, les sociétés américaines qui ont remplacé Gazprom en Europe n’ont bien sûr aucune envie de libérer la place. Et ce n’est qu’un exemple. En d’autres termes, et nous aurons l’occasion d’y revenir dans la Lutte de classe, rien ne dit à quelle échéance et avec quel contenu un accord pourrait se conclure, ni s’il y en aura un.
Rappelons qu’il y a juste dix ans, Russie et Ukraine signaient les accords dits de Minsk-2, sous le patronage de la France et de l’Allemagne. Ceux de Minsk-1, conclus un peu plus tôt, prévoyaient le recul des troupes prorusses et ukrainiennes dans le Donbass : ils n’avaient eu aucun effet. Avec Minsk-2, les combats diminuèrent, mais ne cessèrent pas. Surtout, ses clauses censées garantir la paix (l’octroi d’une large autonomie aux populations russophones du Donbass et la tenue d’élections dans la région) ne furent jamais remplies. Comme l’a reconnu depuis l’ex-chancelière Angela Merkel, elle et le président Hollande avaient cherché à geler le conflit, le temps que les puissances de l’OTAN arment les forces militaires de Kiev.
Les travailleurs face à la bureaucratie et à l’impérialisme
Évidemment, on imagine que de nombreux Ukrainiens, et Russes aussi, ont poussé un soupir de soulagement, se prenant à espérer la fin du cauchemar, de cette guerre fratricide. Mais si Trump ne parle plus de « faire la paix en 24 heures » ni même en un mois, qui oserait prétendre que même d’ici à 24 mois les armes se tairont ?
En attendant, Poutine et les nantis de Russie se mettent à rêver tout haut de redevenir des « partenaires » de l’Occident, de retrouver la liberté de commercer et de s’enrichir dans le monde. Poutine, ravi d’être redevenu fréquentable, abreuve Trump de compliments depuis qu’il a été élu. Poutine vient même de rappeler qu’après sa première élection présidentielle, il avait demandé à l’OTAN d’accepter la Russie, alors que récemment encore il disait que l’OTAN faisait peser une « menace existentielle » sur la Russie et son peuple. Eh oui, même si les dirigeants de l’impérialisme américain n’ont certainement pas abandonné le projet qu’ils caressent depuis la fin de l’URSS, celui de mettre la Russie en coupe réglée comme ils l’ont fait de l’Ukraine, leurs homologues russes aspirent toujours – comme depuis l’émergence de la bureaucratie sous Staline – à normaliser leurs relations avec le monde impérialiste et à s’intégrer à l’ordre capitaliste mondial.
Mais les travailleurs de Russie, et peut-être plus encore ceux d’Ukraine, n’ont absolument rien à attendre d’un éventuel accord Trump-Poutine. La guerre, même si elle devait prendre fin, ils n’ont pas fini de la payer. Ukrainiens et Russes l’ont déjà payée de près d’un million de tués, de blessés et de mutilés en trois ans, d’innombrables destructions de villes, de villages, d’infrastructures en tout genre, surtout en Ukraine, mais aussi dernièrement en Russie, même loin du front. Tout cela, il faudra le reconstruire, et ni les bureaucrates ni les oligarques russes ou ukrainiens ne vont mettre la main à la poche. Ce sont les classes laborieuses qui seront encore et toujours mises à contribution. Et cela par des gouvernants et des autorités que la guerre aura habitués à considérer leur population comme de la chair à canon, et à la réprimer à grande échelle quand elle ne consentait plus aux sacrifices sans fin qu’impliquait l’union sacrée derrière le pouvoir et ses privilégiés. Et Poutine, qui prétendait « dénazifier » l’Ukraine en y envoyant ses tanks, aura sans doute réussi là où les nationalistes ukrainiens avaient jusqu’alors échoué : avec son « opération spéciale », il a creusé un fossé entre travailleurs russes et ukrainiens, il a fait que désormais certains se voient en ennemis, pas en frères et sœurs de classe. Ce qui affaiblit aussi bien la classe ouvrière russe que celle d’Ukraine, en faisant le jeu de leurs pires ennemis.
Cela étant, les exigences des puissances impérialistes et de leurs capitalistes en Ukraine, la rapacité du pouvoir de Zelensky ou de son successeur, la brutalité du régime des bureaucrates et oligarques russes, ne laisseront pas le choix aux travailleurs de ces deux pays. Ou bien ils subiront un joug et une exploitation renforcés, ou bien ils se battront pour les rejeter. En fin de compte, l’alternative ne se présente pas seulement aux peuples de Russie et d’Ukraine, c’est celle à laquelle sont confrontés les travailleurs du monde entier. Et, face à elle, il est indispensable que surgissent des organisations communistes, révolutionnaires, capables de proposer à la classe ouvrière une issue conforme à ses intérêts et à ceux de l’humanité : le renversement du système capitaliste.
18 février 2025