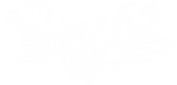C’est à cet événement que Friedrich Engels consacra à l’été 1850 plusieurs articles, qui parurent dans la Neue Rheinische Zeitung, Politisch-ökonomische Revue (Nouvelle Gazette Rhénane, revue politico-économique) dirigée par Karl Marx. Ils furent réunis ensuite en un ouvrage connu sous le nom de La Guerre des paysans en Allemagne. Écrit en exil à Londres, au lendemain de l’échec de la révolution de 1848-1849, le texte d’Engels ne se voulait pas une œuvre d’historien, ni ne prétendait fournir une documentation nouvelle : il emprunta les éléments nécessaires à son travail à un livre écrit quelques années auparavant par Wilhelm Zimmermann, un jeune hégélien1, qui avait participé aux événements de 1848.
Comme Marx, qui avait fait au même moment l’analyse de la révolution de 1848 dans une série d’articles connus sous le nom Les Luttes de classes en France, le but d’Engels était d’appliquer la méthode matérialiste à un fait historique : expliquer l’origine de la révolte des paysans, souligner les rapports entre les classes en action, ainsi que le résultat de la lutte. Il s’agissait, en pointant, au-delà des époques différentes, la similitude du cours général des événements, d’aider tous ceux qui avaient participé aux épisodes révolutionnaires de 1848 à comprendre ce qui venait de se passer, et de les armer pour les combats futurs.
Engels livre donc le récit de la révolte des paysans, faisant ressortir l’énergie révolutionnaire considérable qu’ils déployèrent. Écrasée par les impôts, les corvées, les guerres, les pillages, l’arbitraire permanent des nobles et des prêtres, la paysannerie s’est en effet insurgée à de nombreuses reprises à partir de 1450, brûlant périodiquement châteaux et monastères. Citons la révolte du Bundschuh2, celle du Pauvre Conrad, etc. Malgré des répressions barbares (décapitations, écartèlements, etc.), la flamme de la révolte se ralluma sans cesse, transmise de génération en génération. En 1524, les paysans de différentes régions de l’Allemagne se soulevèrent de nouveau dans un vaste mouvement qui dura deux ans. Ils s’étaient de plus emparé des idées de la Réforme, développées par Martin Luther, qui parlait d’égalité sur terre et pas seulement au ciel. Mais bientôt, effrayé par la profondeur de la révolte de la paysannerie, qui prenait ses paroles à la lettre, Luther rejoignit le camp des nobles, tandis que le prêcheur anabaptiste Thomas Müntzer assuma la direction de l’insurrection, et le paya de sa vie. Pour Engels, le ralliement de la bourgeoisie à la noblesse allemande, en 1848, face à l’émergence politique du prolétariat, offrait un parallèle saisissant avec la guerre des paysans qui s’était déroulée trois siècles plus tôt.
À partir de 1870 le livre d’Engels fut réédité à plusieurs reprises par le Parti social-démocrate allemand naissant et contribua à la formation de nombreux militants. En français, seule est disponible aujourd’hui la réédition réalisée en avril 2021 par les Éditions sociales. Elle comporte une introduction discutant le texte d’Engels avant tout d’un point de vue universitaire, en phase avec l’historiographie aseptisée aujourd’hui à la mode, à la différence de celle du communiste russe David Riazanov pour l’édition française de 1929, aux Éditions sociales internationales3. Depuis 150 ans, la connaissance historique des événements s’est certes affinée. Engels lui-même, dans les dix dernières années de sa vie, avait précisé à plusieurs reprises que son texte méritait d’être remanié et complété, notamment en ce qui concerne le rôle des idéologies religieuses et politiques. Il envisageait même de l’intégrer dans une vaste histoire de l’Allemagne. Accaparé par des tâches plus urgentes, il n’a pas eu le temps de le faire. Il nous reste donc ses analyses et raisonnements. Encore une fois, son ouvrage n’avait pas un but historique mais militant. La seule lecture que peuvent en faire ceux qui se posent toujours le problème de changer le monde demeure celle-là.
18 février 2025
Friedrich Engels, La Guerre des paysans en Allemagne.
Traduction d’Émile Bottigelli. Paris, Les Éditions sociales, 2021.
Prix : 15 euros.
1 Disciple du philosophe allemand Georg Hegel reprenant sa méthode de raisonnement (la dialectique) mais voulant développer son potentiel révolutionnaire.
2 Littéralement : le soulier à lacets, porté par les paysans.
3 L’édition préfacée par David Riazanov est en libre accès : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30755958