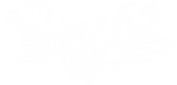Au point qu’en 1971, l’annonce d’un match de ping-pong en Chine entre une équipe chinoise et une équipe américaine et en 1972, la poignée de main entre Nixon, président des États-Unis, et Mao Zedong, sur le sol chinois sont apparues quasiment comme un événement planétaire : enfin, la Chine s’ouvrait au monde occidental ! Et quand, en 1984 (il aura fallu tout de même 12 ans), la Chine participa à ses premiers Jeux olympiques, à Los Angeles, ce fut la confirmation ! Elle semblait bien avoir rejoint le concert des nations, d’autant que le dirigeant de l’époque, Deng Xiaoping, à la tête du PC chinois et avec son accord, encouragea les initiatives individuelles de type capitaliste.
La Chine s’était effectivement ouverte. Mais les Occidentaux n’ont pas pu y faire ce qu’ils voulaient. Les firmes étrangères ont obtenu le droit de s’y installer et l’accès au marché chinois, mais à condition de transférer leurs technologies. Cette ouverture a été le point de départ d’une industrialisation et d’un accroissement de la classe ouvrière gigantesque. Mais la pénétration des entreprises étrangères a été dirigée et encadrée par l’appareil d’État chinois. Et si la puissante industrie chinoise a réussi à produire tant et plus, à devenir « l’atelier du monde » et à vendre sur le marché mondial, les produits étrangers ne sont pas parvenus à envahir le marché chinois autant qu’ils l’espéraient, la population étant trop pauvre pour y avoir accès.
À sa façon, la Chine reste encore impénétrable. Même aujourd’hui, alors qu’elle semble s’être ouverte au marché dominé par l’impérialisme, son marché intérieur reste difficilement accessible car protégé quasi militairement par le PC, lui-même issu d’une révolution sociale qui avait mis en marche des centaines de millions de paysans et bouleversé de fond en comble la vieille Chine même si le PC, à la tête de l’État, semble par bien des aspects s’être coulé dans les empreintes du vieil empire chinois millénaire.
Une nouvelle Chine était née après l’ouverture forcée, provoquée par les Anglais lors des guerres de l’opium. S’ouvrait alors une ère de révolutions : révolution nationaliste de 1911, écrasée, révolution prolétarienne de 1927, écrasée, révolution paysanne et nationaliste victorieuse de Mao, qui avait pris le nom de communiste sans être le moins du monde prolétarienne (question d’époque !). Rentrée de force dans le monde moderne, dans quel camp la Chine allait-elle se ranger ?
Tel est le thème qui sera abordé en trois parties. Ce premier article traitera des guerres de l’opium. Le 20e siècle, période d’ébranlement et ère de révolutions, sera abordé dans un prochain numéro de Lutte de classe, et la place de la Chine dans l’économie mondiale, sous l’angle de sa coupure avec le marché mondial, le sera dans un numéro ultérieur.
Les guerres de l’opium : une tentative brutale de contraindre la Chine à s’ouvrir au commerce étranger
Cette résistance au commerce britannique, alors que celui-ci était en pleine expansion au 19e siècle, allait tellement à l’encontre des visées des Anglais en Orient qu’ils se lancèrent dans une opération pour faire tomber les barrières au libre-échange érigées par l’empire chinois. Une seule denrée, à ce moment-là, réussissait à pénétrer facilement en Chine, sans les tracasseries administratives des fonctionnaires, l’opium, arrivé en contrebande par des voies souterraines et officieuses. Les Anglais s’en emparèrent comme d’un boutoir. Et pour l’imposer, ils se lancèrent dans les guerres de l’opium, guerres infamantes s’il en fut.
« Bien sûr, le commerce des esclaves avait quelque chose de miséricordieux par rapport au commerce de l’opium : nous ne ruinions pas l’organisme des Africains, car il était de notre intérêt immédiat de les maintenir en vie ; nous ne dépravions pas leur nature, ni ne corrompions leur esprit, ni ne tuions leur âme. Or, le vendeur d’opium tue le corps après avoir perverti, dégradé et ruiné l’âme des malheureux pêcheurs. À chaque heure qui passe, on sacrifie de nouvelles victimes à cet insatiable Moloch », déclare Montgomery Martin, représentant anglais en Chine, cité par Marx, non sans une certaine ironie1. Il faut croire que lorsque les commerçants s’y mettent, ils n’y vont pas de main morte… !
Une affaire anglaise
Au 17e siècle, la Grande-Bretagne, engagée sur la voie du développement capitaliste et qui avait enfin tourné son industrie vers la mer, avait commencé à voir affluer les richesses sur son territoire, grâce notamment aux expéditions des flibustiers qui attaquaient et pillaient les navires des nations dominantes de l’époque. Le nom de certains bateaux anglais, comme le Why not I ? (Pourquoi pas moi ?), est sans équivoque sur le caractère anglais qui se forgeait alors, un caractère de contrebandiers, et d’opportunistes ayant tous les droits si cela rapporte.
Ainsi, au 18e siècle, la Grande-Bretagne avait la prétention de prendre sa place parmi les grandes puissances et obtint même de participer au commerce des esclaves à l’égal du Portugal, de l’Espagne et des Pays-Bas qui en avaient le monopole auparavant. Des hommes souvent partis de rien y firent fortune. Les négriers de Liverpool furent alors connus pour leurs propos cyniques sur la traite des Noirs : d’après eux, un commerce des plus prospères, le plus à même de développer l’esprit d’entreprise et de garantir la réussite des jeunes hommes.
Au siècle suivant, le pays était tiré en avant par sa production quasi industrielle de bateaux et de canons, l’État s’appuyait sur une force sociale nouvelle : la bourgeoisie industrielle ; le commerce anglais se développait, la bourgeoisie s’enrichissait, et au fur et à mesure, sa brutalité et son sentiment de supériorité d’appartenir à une nation dominant les autres s’accroissait.
Pour répondre au besoin de la bourgeoisie de balayer les contraintes du vieux monde, c’est-à-dire toute loi restreignant sa course en avant, le Parlement se lança dans une campagne pour lui obtenir le libre-échange. C’était l’ère de la brutalité et du cynisme, mais aussi celle de la folie des grandeurs. La reine Victoria ne finit-elle pas par se faire couronner impératrice des Indes ? Alors que plus rien ne semblait résister au capital anglais, un territoire restait fermé à son commerce : la Chine. Cet empire millénaire trônait en Asie, impénétrable, comme un défi.
Au cours du 19e siècle, la bourgeoisie anglaise considéra comme une mission sacrée d’ouvrir la Chine. Mais ses tentatives pour imposer des relations commerciales à son avantage restaient vaines, et piquée qu’elle était dans ce qu’elle estimait être son droit au libre-échange sur le monde, celui d’aller, venir, commercer et voler librement, il n’y avait pas de crime qu’elle n’oserait commettre pour arriver à ses fins.
Une Chine impénétrable
Les Britanniques savaient qu’il était difficile de commercer avec la Chine. De fait, ils se heurtaient à une première difficulté et de taille : les côtes et tous les ports chinois leur étaient interdits sauf Canton. Pour acheter les objets de luxe, soie et porcelaine et surtout le thé dont la consommation en Angleterre montait en flèche, il n’y avait que cette porte d’entrée et encore, uniquement quelques mois par an, « à la saison du thé ». De plus, un navire ne pouvait-il y accoster directement ; il devait mouiller à bonne distance et attendre que l’administration chinoise arrive pour peser, compter, enregistrer la cargaison et tout noter.
Les fonctionnaires étaient nombreux : le mandarin local et sa suite ; le représentant du Cohong, la guilde des marchands de Canton qui avait le monopole du commerce avec les étrangers ; les « interprètes » qui, malgré leur titre, ne parlaient pas anglais mais tenaient les registres de douane, trouvaient des chaloupes pour transporter les marchandises à Canton, embauchaient bateliers, porteurs, domestiques… Chacun des fonctionnaires rendait compte à son supérieur de tout ce qui touchait aux étrangers. Au-dessus du mandarin, il y avait le gouverneur de Canton qui supervisait les rapports et enfin transmettait le sien à l’administration impériale de Pékin.
Les Anglais avaient essayé à plusieurs reprises de contourner la surveillance de ces mandarins en abordant dans d’autres ports le long de la côte, mais seulement pour être délogés ou soumis à des taxes encore plus élevées.
Ils se heurtaient donc, en Chine, à un vrai appareil d’État centralisé. Les mandarins pouvaient être corrompus, stupides, arrogants, voleurs, ils étaient là, chacun adossé à cet immense édifice tentaculaire, centralisé, installé depuis des siècles. Il y avait beau y avoir une multitude de peuples, d’ethnies, de langues, au-dessus il y avait cet appareil armé d’une vraie culture de l’administration, de la codification, de la réglementation.
Quant à la société que les mandarins administraient, elle pouvait fonctionner en étant repliée sur elle-même, sans que les marchands anglais puissent s’y intégrer. Ainsi, dans les villages, les corvées nécessaires au maintien de l’Empire, telles que les travaux d’irrigation ou la constitution de stocks de semences, pouvaient être réalisées en mobilisant les nombreux paysans. Les tissus et les outils produits dans les villages, bien que primitifs, suffisaient à leur quotidien.
Le clan était une entité sociale de plusieurs centaines d’individus définie au sommet par un ancêtre et nourrie et entretenue à la base par des paysans pauvres. Cette masse, très nombreuse, de paysans, cultivant chacun un minuscule terrain, parfois sans terre et contraints de se louer, bénéficiait en contrepartie de la solidarité inconditionnelle du clan.
Dans cette société homogène parce que figée, les Anglais, avec leur commerce et leurs outils modernes, n’avaient aucun moyen d’introduire un coin d’autant que, à cause de son extrême pauvreté, la population vivait repliée sur elle-même à tenter de survivre dans des conditions pires que le servage. Cette situation agissait comme un ciment étanche freinant toute pénétration en profondeur. C’était une société immobile, imperméable, traversée de temps en temps par des explosions violentes comme lorsque les digues d’un fleuve impétueux se rompent.
Le confucianisme formait la morale corsetant cet ensemble, où chacun devait participer à l’harmonie sociale. Il était, d’une part, au service des clans en inculquant le culte des ancêtres, et, d’autre part, au service de l’autorité de l’empereur, qui se posait en père protégeant tous ses sujets.
Face à ces obstacles, un chemin, fruit du hasard et de la frénésie des marchands anglais, allait voir le jour, grâce à l’opium ! Cette marchandise n’avait que des avantages car ses voies de pénétration sont forcément souterraines et officieuses et son pouvoir addictif suffit à sa diffusion. Dès la fin du 18e siècle, la Compagnie anglaise des Indes se lança dans la création à perte de vue de plantations de pavot au Bengale, afin de le répandre en Chine.
Ce sont les mandarins eux-mêmes qui tombèrent sous sa dépendance. Dans son livre L’accumulation du capital (1913), Rosa Luxemburg cite un rapport d’enquête de 1828 qui décrit à l’empereur de quelle façon ils le diffusent : « Il semble que l’opium soit surtout importé par des fonctionnaires indignes qui, en accord avec des négociants cupides, le font parvenir à l’intérieur du pays ; là, ce vice est d’abord pratiqué par des jeunes gens de bonne famille, par de riches particuliers et des marchands et il se répand finalement dans le peuple. J’ai appris qu’il existe des fumeurs d’opium dans toutes les provinces, non seulement parmi les fonctionnaires civils mais aussi dans l’armée. Tandis que les fonctionnaires des différents districts renforcent par des édits l’interdiction légale de la vente de l’opium, leurs parents, leurs amis, leurs subordonnés, leurs serviteurs continuent à fumer comme auparavant et les négociants profitent de l’interdiction pour faire monter les prix. La police elle-même, gagnée à ces habitudes, achète la drogue au lieu d’aider à la faire disparaître, et c’est aussi la raison pour laquelle les interdictions et les mesures légales restent peu appliquées. »2
Le trafic de l’opium avait pris des proportions gigantesques, passant de 200 caisses au milieu du 18e siècle à plus de 12 000 en 1825, et plus du triple de cette quantité en 1840.
Mais la Compagnie des Indes, cette vieille ancêtre commerciale qui, depuis plus de deux siècles, avait tenu sur les fonts baptismaux et accompagné toutes les victoires et déboires de l’expansion anglaise, n’était plus en mesure de faire face au développement illimité de la production anglaise et encore moins d’assurer des tâches régaliennes, celles d’un appareil d’État que l’expansion britannique lui imposait !
Cette association de marchands s’était donc trouvée dans des positions d’administration de territoires de plus en plus étendus en Inde, dépassant de loin la simple construction de comptoirs commerciaux. Un député au Parlement le constatait en 1830 : « L’idée de confier à une association par actions […] l’administration politique d’un Empire peuplé de 100 millions d’âmes […] était absurde. »
La transformation qui s’opérait pour la Compagnie signifiait son déclin progressif et la reprise en mains de son administration par l’État britannique.
Première guerre de l’opium : la politique de la canonnière
Si les Britanniques n’étaient pas de taille à envahir la Chine, lors des premiers combats, ils s’étaient rendu compte qu’avec seulement quelques navires, ils pouvaient tenir en respect la marine chinoise, grâce aux atouts que leur procurait leur avance industrielle et technique. Les canons anglais tiraient plus loin et avec plus de précision que ceux des Chinois, ce qui leur permettait de bombarder sans s’exposer eux-mêmes.
En 1839, après qu’un envoyé de l’empereur à Canton eut mis sous séquestre les stocks d’opium pour obliger les Anglais à cesser leur trafic, et qu’excédé par plusieurs semaines de refus, il eut fait brûler et jeter à la mer les 20 000 caisses d’opium, en représailles, la flotte de l’Angleterre attaqua plusieurs ports de la côte. La première guerre de l’opium était commencée. Les canonnières, navires à vapeur cuirassés d’acier, équipés de canons mobiles et de fusées explosives, étaient le maître atout de leur politique. Elles coulèrent des dizaines de navires et ruinèrent les fortifications chinoises.
Deux ans plus tard, en 1841, acculé, l’Empire était prêt à faire des concessions. Mais les Anglais voulaient montrer qu’ils étaient les maîtres. En 1842, ils remontèrent le fleuve Yangtsé jusqu’à Nankin, où ils paralysèrent le grand canal impérial. L’empereur n’eut d’autre choix que d’accepter leurs conditions.
Le traité de Nankin garantit aux Anglais l’ouverture au commerce des cinq ports que les Anglais avaient attaqués. Hong-Kong qu’ils avaient occupé passa sous juridiction anglaise. L’Empire dut payer une indemnité de 21 millions de dollars pour l’opium détruit en 1839, dette exorbitante qui fut prélevée sur la population, et le pouvoir fut forcé de renoncer à poursuivre les trafiquants.
L’entrée en décomposition de la Chine
Les industriels britanniques, surexcités par l’ouverture du marché chinois, supposé énorme, produisirent et expédièrent à l’aveugle variété et quantité de marchandises (cotonnades mais aussi pianos, couteaux et fourchettes !) dont la vente couvrit à peine les frais de transport. Pour cause, les Chinois n’en avaient pas plus besoin qu’avant, la paysannerie chinoise vivant en quasi-autarcie. C’est l’opium, seul « commerce » que la guerre libéra, qui absorbait la plus forte quantité d’argent chinois. Ce trafic ne semblait connaître aucune limite, jusqu’à épuiser les finances impériales.
L’opium finançait le gouvernement de l’Inde et il était le seul moyen de payer les importations massives de thé chinois. Ce thé, revendu avec profit en Angleterre, constituait une rentrée fiscale majeure pour le trésor britannique, équivalente au budget de la Royal Navy.
Ce système était profitable mais fragile : en effet, d’une part l’opium, malgré l’addiction des consommateurs, restait une denrée soumise au bon vouloir du pouvoir central ; d’autre part, la production de thé connaissait des aléas. Car le pouvoir, pris à la gorge par les sorties massives d’argent, à cause de l’opium, avait été contraint de développer en grand les plantations de thé, seule marchandise exportable. C’était au détriment de l’agriculture traditionnelle, ce qui ruinait les paysans et entraînait des révoltes.
Les rivalités impérialistes précipitent la seconde guerre de l’opium
L’Empire britannique était devant un problème de fond : alors que son industrie était en pleine expansion, les débouchés pour ses produits ne suivaient pas, ce qui conduisit à la crise générale de 1847. Cette crise déstabilisa le commerce en Chine et menaça de réduire les débouchés que la Grande-Bretagne avait déjà. Ayant perdu ses colonies américaines, elle était obsédée par l’idée de pénétrer plus avant en Chine, dans l’intérieur des terres, car c’était sa dernière perspective de taille.
Mais elle n’était plus seule en Chine. Arrivée la première, l’Angleterre avait ouvert les ports de Chine à coups de canons. La France et les États-Unis avaient suivi et établi eux aussi des concessions. Ils étaient des rivaux sérieux dans l’océan Pacifique, nouveau centre de gravité des échanges mondiaux. La Russie, de son côté, possédait ses propres entrées en Chine, par voie terrestre.
L’Angleterre faisait jusque-là la course en tête, parce que c’est elle qui avait porté le fer en premier. Elle avait sur place plus de navires et plus de troupes que les autres puissances, et avait intérêt à mener une guerre qui, en alliance avec les autres, lui rapporterait davantage à elle.
En 1856, la police chinoise captura un navire de contrebandiers chinois, l’Arrow. Les potentats britanniques de Canton prétendirent que ce navire battait pavillon britannique, firent semblant d’avoir été attaqués et attaquèrent la ville. À Londres, le Premier ministre, Palmerston, décida une intervention armée, bientôt suivi par la France et la Russie, tandis que les États-Unis optèrent prudemment et hypocritement pour la neutralité, tout en portant assistance aux flottes occidentales.
L’Empire fut donc à nouveau canonné et céda en 1858. Le traité de Tientsin accordait le droit pour la Russie, l’Angleterre, les États-Unis et la France d’établir des ambassades à Pékin, l’ouverture de nouveaux ports, la circulation sans entrave à l’intérieur de la Chine et la légalisation de l’opium.
La véritable bénéficiaire de la guerre avait été la Russie qui, sans combattre, s’était vu céder un important territoire au nord de la Chine.
Les Anglais, mécontents, se relancèrent dans la guerre, suivis de près par les Français avides de jouer leur partie. Une flotte de canonnières (cela devenait une habitude) remonta en 1860 le fleuve Pei-Ho jusqu’à Pékin. La ville fut mise à sac et le palais impérial incendié. Cette barbarie obligea l’Empire chinois à une convention séparée, octroyant aux Anglais des avantages supplémentaires.
L’empereur avait fui au moment du sac de Pékin. À défaut de permettre aux Britanniques de vendre leurs marchandises en Chine, les deux guerres de l’opium avaient ouvert une plaie béante dans la société chinoise.
La dissolution de la vieille Chine
Après l’irruption violente des Occidentaux, la Chine se retrouvait le ventre ouvert.
Le pouvoir central fut désemparé. La cour impériale était confinée dans la Cité interdite, une ville à part entière, peuplée de dizaines d’épouses et de concubines de l’empereur, de membres de la famille impériale, de milliers d’eunuques et de mandarins strictement organisés en grades et répartis dans une multitude de services, effectués par une multitude de serviteurs. Cette cour vivait en vase clos, dans ses palais, ses cours, ses pavillons, ses jardins, volontairement isolée du peuple afin de renforcer l’idée de sa puissance sacrée, perpétuellement agitée de complots de clans les uns contre les autres.
Le pouvoir était incapable même de comprendre ce qui se passait, se cramponnait à tout ce qui était le plus réactionnaire ; mû seulement par son hostilité au modernisme apporté par les étrangers, il était atteint de paralysie chronique.
La paysannerie était entrée en ébullition dès la première guerre de l’opium. Pas une région où il n’y eut une révolte contre les mandarins déconsidérés et un pouvoir impérial ayant perdu tout crédit. La plus importante fut celle des Taiping. Ce fut un soulèvement sauvage de paysans pour la terre et contre le pouvoir, violent et irrépressible au point que durant treize ans, les troupes impériales ne purent plus mettre un pied en Chine du Sud. Ils partagèrent les terres et brûlèrent les centres administratifs. Ses dirigeants, issus de la petite bourgeoisie des campagnes, découvrirent à leur façon le modernisme dans les villes du sud ouvertes aux Occidentaux, et dès le début, ils voulurent renverser la dynastie et affirmer leur rupture avec le confucianisme et le culte des ancêtres. Sans perspectives, ils tombèrent rapidement dans la caricature du pouvoir impérial, se constituant une cour qui singeait la cour impériale, et ils perdirent l’appui de la paysannerie qu’ils pillaient et taxaient, sombrant dans les luttes entre chefs avant que les armées occidentales ne leur donnent le coup de grâce, sauvant ainsi l’Empire.
Conclusion
« L’isolement total était la condition nécessaire de la préservation de la vieille Chine. Aujourd’hui que cet isolement a brutalement cessé par l’action de l’Angleterre, la dissolution de la vieille Chine est tout aussi certaine que celle d’une momie soigneusement conservée dans un sarcophage hermétique clos que l’on expose au grand air. Maintenant que l’Angleterre a déchaîné la révolution en Chine, nous devons nous demander quelle réaction cette révolution va entraîner dans ce pays »3.
Voilà ce que Marx écrivait en 1853, et c’était d’autant plus vrai en 1860, à la fin de la deuxième guerre de l’opium. Après deux défaites cuisantes, ajoutées au sac et à l’incendie de la cité impériale, le symbole par excellence du pouvoir venait d’être mis à bas.
La survie de la cour impériale était menacée. D’autant que l’immobilisme imbécile de cette dernière ne faisait qu’accélérer le tremblement de terre qui déjà ébranlait le pays et dont les ondes commençaient à atteindre les couches les plus reculées de la paysannerie.
Les multiples soulèvements des paysans qui se rangèrent un temps derrière les Taiping firent apparaître de larges failles au sein de la population. L’historien John Fairbank décrit « des rangées de paysans, le corps plié en deux et les chevilles enfoncées dans l’eau boueuse, [qui] se déplac[ent] à reculons, étape après étape, le long des terrasses de culture. […] probablement la plus grande dépense d’énergie musculaire à l’œuvre sur terre. […] Une fois établie, cette économie ne pouvait que gagner son propre mouvement d’inertie et s’y tenir. »4
Mais l’équilibre était rompu, laissant une paysannerie exténuée et avide de terre face à des propriétaires fonciers et des fonctionnaires d’État toujours plus exigeants de produits de la terre et d’impôts.
Le pouvoir central étant défaillant, le respect des ancêtres devenait alors inopérant ! Les campagnes explosaient littéralement, treize ans de guérilla, près de trente millions de morts, le mouvement des Taiping sera un échec mais il aura ouvert l’ère des bouleversements en Chine. Donnant partiellement une réponse aux interrogations de Marx. Pour Marx, après les guerres de l’opium, la vieille momie de la Chine ne rentrait plus dans le sarcophage, le passé était révolu !
Même cet immense pays, peuplé de centaines de millions de paysans, attachés aveuglément à leur terre, reproduisant leur mode de vie immuablement depuis des millénaires, n’y pouvait rien. Désormais, le capitalisme était aux commandes avec son commerce agressif, ses guerres de rapine, son surarmement moderne et démesuré.
Une ère de bouleversements, de guerres et de révolutions s’ouvrait. La Chine, malgré une résistance acharnée, se trouvait forcée de rentrer dans le monde contemporain.
15 janvier 2025
1Karl Marx, New York Daily Tribune, 20 septembre 1858. Martin était le trésorier du consulat britannique en Chine et membre du Conseil législatif à Hong-Kong.
2Rosa Luxemburg, L’accumulation du capital, 1913 (ch. 28 : L’introduction de l’économie marchande).
3Karl Marx, « La révolution en Chine et en Europe », New York Daily Tribune, 14 juin 1853.
4John K. Fairbank, Histoire de la Chine. Des origines à nos jours, Tallandier, 2013.