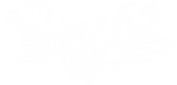Trump assomme le monde de ses prétentions. Après avoir menacé d’annexer le Canada, le Groenland et le canal de Panama, il prétend prendre le contrôle de la bande de Gaza. Fidèle à son esprit cupide de promoteur immobilier, il entend en faire un paradis pour riches touristes à l’image de la Côte d’Azur, quitte à en expulser deux millions de Palestiniens, ce qui sonne doux aux oreilles des dirigeants israéliens.
À travers Trump, c’est la véritable nature du capitalisme qui s’exprime, sans fard. Le voile hypocrite du droit international, que les États impérialistes prétendaient faire respecter et qui justifie habituellement leurs sales guerres, tombe. Trump ne s’en embarrasse pas et parle le seul langage qui compte dans cette jungle : celui de la force. Et il faut toute l’hypocrisie des seconds couteaux de l’impérialisme ou du Parti démocrate pour s’en indigner. Car avec un langage habituellement plus policé, ils poursuivent les mêmes buts. Si Trump peut cyniquement envisager de transformer Gaza en station balnéaire, c’est parce que son prédécesseur Biden a livré à l’État israélien les bombes qui ont transformé ce territoire en un champ de gravats.
La dictature de la bourgeoisie
La réélection de Trump s’inscrit dans une lame de fond réactionnaire marquée par une campagne très à droite dans laquelle les Républicains ont imposé leurs thèmes, tout comme celle de 2016, qui déjà s’était faite sur le dos des migrants. Cette propagande nauséabonde alimentée par des flots de propos racistes quotidiens visant les migrants s’intensifie. Elle aggrave les divisions au sein de la classe ouvrière en confortant les préjugés d’une partie d’entre elle, ce qui contribue à lui faire perdre de vue ses véritables ennemis : les grands capitalistes.
Derrière l’apparente rupture que constitue le retour aux affaires de Trump, sa présidence témoigne de la continuité de la dictature de la grande bourgeoisie, qui prospère dans un pays où la situation de la classe ouvrière s’aggrave et ce, quels que soient les soubresauts qui secouent les institutions de l’appareil d’État américain. En cela, le système bipartisan remplit encore sa fonction essentielle : démocrate ou républicain, les deux partis de la bourgeoisie américaine alternent aux affaires, entraînant l’illusion du changement et camouflent l’essentiel, la domination de la classe capitaliste.
Pour autant, le second mandat de Trump intervient à l’heure d’un approfondissement de la crise de l’économie capitaliste dans un monde sur le pied de guerre. C’est pourquoi sa présidence peut faire franchir une étape de plus à l’escalade des tensions en cours et en être un facteur aggravant.
Trump l’emporte sans être majoritaire
Trump l’a emporté à l’issue d’une campagne qui n’a soulevé aucun enthousiasme dans les classes populaires. Aux abstentionnistes, de l’ordre de 36 %, s’ajoutent les 22 millions d’étrangers écartés du droit de vote et les quelque 4,4 millions d’Américains privés de leurs droits civiques après une condamnation judiciaire. Au total, c’est presque un adulte sur deux vivant aux États-Unis qui ne s’est pas prononcé.
Trump a certes devancé Harris, élargissant légèrement sa base électorale au passage. Mais rapportée au nombre total d’électeurs inscrits, elle n’en représente qu’un tiers. Trump a récolté les voix de l’électorat traditionnellement conservateur, xénophobe voire raciste, bigot et anticommuniste que compte le pays. Mais de nombreux travailleurs ont aussi cédé à sa démagogie. À l’inverse des Démocrates, il a orienté une partie de sa démagogie en direction de la classe ouvrière, promettant de lutter contre l’inflation, de relocaliser la production, de protéger les emplois de la concurrence étrangère, allant jusqu’à prétendre défendre, avec le mépris raciste qui le caractérise, les « emplois noirs », suggérant ainsi que les emplois peu qualifiés seraient menacés par une prétendue submersion migratoire. Il a été indirectement aidé par la bureaucratie syndicale et la gauche du Parti démocrate, qui apportent en permanence leur pierre à cette propagande nationaliste et protectionniste. Début février, le syndicat de l’automobile UAW, dirigé par Shawn Fain, qui passe pour radical et combatif, a « approuvé les tarifs douaniers agressifs pour protéger les emplois industriels américains » et demandé à Trump « de renégocier les traités de libre-échange ». Plutôt que d’éclairer les travailleurs sur la nature bourgeoise de la politique de Trump, ce syndicat influent prétend le conseiller, demandant « s’il est sérieux s’agissant de ramener les emplois industriels détruits par les traités ».
Les postures de Trump contre l’establishment, affichant son mépris pour les élites politiques, médiatiques, les stars de cinéma, ont plu à une partie des classes populaires, qui s’enfoncent dans la pauvreté. Elles ont fait vibrer un dégoût bien légitime à l’encontre de ce monde de privilégiés bien-pensants auxquels leur richesse permet de vivre à l’écart des milieux populaires. Mais en plébiscitant un grand bourgeois milliardaire, lui-même issu de ce sérail et ardent défenseur de l’exploitation capitaliste, les travailleurs qui ont voté pour lui se sont trompés. À cet égard, l’absence d’un parti défendant les véritables intérêts politiques et matériels du prolétariat américain se fait cruellement sentir.
La défaite des démocrates sanctionne leur politique antiouvrière
En fait de victoire républicaine, l’élection sanctionne surtout une débâcle démocrate. À l’été 2024, la nomination de Kamala Harris, une femme noire, était censée donner un nouveau souffle à ce parti discrédité par quatre ans aux affaires et jusque-là représenté par un Biden sénile. En guise de programme, la vice-présidente Harris a vanté le bilan économique du président sortant, expliquant qu’ils avaient réussi à contenir l’inflation. Pour les dizaines de millions de travailleurs américains endettés jusqu’au cou et rackettés au quotidien par la grande distribution, c’était évidemment un discours inaudible. Pendant sa courte campagne, Harris a récolté plus d’argent que Trump : elle était tout autant que lui la candidate de la bourgeoisie.
Harris a bien tenté d’apparaître comme un rempart face au danger Trump en s’appuyant sur la crainte bien justifiée que le droit à l’avortement soit encore plus remis en cause à l’échelle du pays. Mais l’élection ne s’est pas jouée principalement sur cette question.
Aux lendemains de la défaite, les Démocrates ont été prompts à l’attribuer au fait que les esprits n’étaient pas mûrs pour porter une femme noire au pouvoir. Ils ont déploré la progression du vote républicain chez les hommes noirs et hispaniques. En rejetant la faute sur l’électorat populaire, ces explications présentaient l’avantage bien commode de ne pas discuter de la perte de plus de six millions d’électeurs démocrates entre 2020 et 2024. Que représentait-elle, sinon la sanction de la politique antiouvrière de Biden ?
Quant à Bernie Sanders, sénateur du Vermont, à la tête d’un courant dit « socialiste » à l’intérieur du Parti démocrate, il s’est fendu d’une vidéo, le lendemain des résultats, expliquant que les Démocrates avaient perdu parce qu’ils ne s’étaient pas adressés au monde du travail. Or la veille encore, il trompait ceux qui lui faisaient confiance en couvrant Harris de louanges dans les publicités financées par l’appareil démocrate. Les travailleurs ne peuvent accorder aucun crédit à ces girouettes.
Un gouvernement des milliardaires, pour les milliardaires, par les milliardaires
Le jour de son investiture, Trump a affiché sa couleur réactionnaire, conviant notamment la cheffe du gouvernement italien, Meloni, et le président argentin, Milei. À côté d’eux siégeaient les véritables maîtres de la société : les plus grands bourgeois de la planète occupaient ainsi les premiers rangs, à commencer par le plus riche d’entre eux, Elon Musk, qui a lancé deux saluts nazis, actualisant l’admiration ancienne d’une partie de la grande bourgeoisie pour le régime antiouvrier d’Hitler. Depuis qu’il trempe en politique, le patron mégalomane de Tesla met sa fortune au service des idées d’extrême droite. Il s’affiche en soutien de l’AfD en Allemagne et accuse l’Afrique du Sud de racisme antiblanc, exprimant sans doute sa propre nostalgie pour le réel racisme antinoir du régime d’apartheid dans lequel il a grandi. Musk, qui a versé 240 millions de dollars à la campagne de Trump, est en train de recueillir son retour sur investissement. Il vient en effet d’intégrer la nouvelle administration. Dans un monde où la concurrence fait rage dans les secteurs où ses entreprises prospèrent (voitures électriques, espace, intelligence artificielle), il s’assure en personne que ses intérêts seront défendus.
Les géants de la « tech » Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Sundar Pichai (Google), Tim Cook (Apple) complétaient, entre autres, le tableau ; ainsi que Bernard Arnault et ses 200 milliards qui comptent plus pour Trump, parangon du patriotisme américain, que sa nationalité française. En bon bourgeois qui ne s’oublie pas, Trump a profité de son investiture pour faire la publicité de sa cryptomonnaie, lancée quelques heures auparavant. Avec lui, les choses sont claires : la grande bourgeoisie se mêle directement de la marche de l’État.
Les travailleurs immigrés attaqués en premier
Immédiatement, Trump s’est mis en scène en homme d’action signant à la chaîne des décrets sous l’œil des caméras. Mais parmi ceux-ci, aucun n’est de nature à enrayer la chute du niveau de vie de la population travailleuse ni à augmenter le salaire fédéral minimum fixé à 7,25 dollars (7 euros) de l’heure.
Trump a menacé le Canada, le Mexique, l’Union européenne, la Chine, etc., de guerre commerciale. Que cela contribue à l’augmentation générale des prix, ce qu’il a lui-même concédé, disant que ces tarifs douaniers auraient des conséquences « un peu douloureuses pour la population », n’est qu’une des multiples contradictions de ce démagogue qui promettait de lutter contre l’inflation.
Durant la campagne et à longueur de meetings, Trump a répété sur tous les tons que l’Amérique était submergée par des hordes de millions de criminels, d’aliénés, de violeurs, allant jusqu’à accuser les migrants d’« empoisonner le sang » de l’Amérique avec leurs « mauvais gènes ». À son électorat le plus xénophobe, il a promis des arrestations et des déportations massives. Sans surprise, il concentre dès à présent ses attaques les plus brutales sur cette fraction la plus exploitée du prolétariat américain. Il a décrété la fin du droit du sol pour les enfants nés sur le territoire mais de parents étrangers, contrevenant au 14e amendement de la Constitution américaine. Pour l’instant la décision a été bloquée par des juges.
Trump a ordonné à l’armée de fournir des moyens aériens pour organiser des déportations de sans-papiers, qu’il médiatise, vers l’Amérique centrale, l’Inde ou la base américaine de Guantanamo, sur l’île de Cuba. En outre, il a étendu les pouvoirs de la police de l’immigration en levant les restrictions qui l’empêchaient, en théorie, de perquisitionner dans les écoles ou les églises. Début février, alors que des rumeurs de rafles se répandaient sur les réseaux sociaux, de nombreux parents sans papiers ont fait le choix de ne pas envoyer leurs enfants à l’école.
L’économie américaine repose sur la surexploitation de dizaines de millions de travailleurs venus du monde entier et en particulier d’Amérique latine. Ceux-ci sont indispensables dans la construction, la santé, l’agriculture, les services, les transports, etc. De ce point de vue, des déportations massives visant ces travailleurs déjà intégrés à l’économie américaine semblent peu réalistes car la bourgeoisie a besoin de cette main-d’œuvre et le fait savoir. En revanche, le patronat profitera du climat de terreur instauré par Trump et de l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de ces travailleurs pour aggraver leur exploitation et, par ricochet, celle de tous les travailleurs des États-Unis.
Lorsque Trump ordonne d’augmenter le nombre des expulsions quotidiennes, il met ses pas dans ceux des administrations précédentes, démocrates et républicaines. Clinton le démocrate (1993-2001) avait fait expulser 12 millions de personnes, devançant de deux millions Bush le républicain (2001-2008). Avec environ 4,4 millions de reconduites à la frontière, soit presque autant qu’Obama en huit ans, Biden a fait pire que Trump durant son mandat.
Mais le problème ne réside pas seulement dans l’ampleur des expulsions, aussi massives soient-elles, que Trump prétend maintenant assumer. Ce qui change avec lui, c’est qu’il accompagne sa politique d’une démagogie raciste et xénophobe qui vise consciemment à diviser le monde du travail. La situation exigerait au contraire son unité la plus large pour faire face à la guerre de classe que la bourgeoisie lui impose et qui ira en s’intensifiant.
La menace d’extrême droite
Au moment de sa prise de fonction, l’un des premiers gestes de Trump a été de gracier quelque 1 500 émeutiers condamnés pour l’invasion du Capitole le 6 janvier 2021, lorsque la frange fascisante de sa base avait entrepris un coup de force pour contester sa défaite. En les amnistiant, Trump a conforté son autorité auprès de cette extrême droite. À l’instar d’Enrique Tarrios, admirateur de Pinochet et dirigeant de la milice néonazie des Proud Boys, ces militants qui ont passé quelques mois en prison en sortent moralement et politiquement blanchis. Tout au long de la campagne, le souvenir de cette journée a fait planer la menace de violences dans le cas où Harris l’emporterait. Les partisans de Trump prêts à l’action se sentaient d’autant plus légitimes à entretenir le spectre d’un nouveau passage à l’action que leur leader avait échappé à deux tentatives d’assassinat à l’été 2024.
Les Démocrates qui avaient, des mois durant, présenté Trump comme un dictateur menaçant la démocratie américaine, lui ont sagement cédé le pouvoir en janvier, faisant preuve, comme à leur habitude, d’un grand respect pour la continuité des institutions de l’État américain. Ce n’est certainement pas sur eux que les travailleurs pourront compter pour combattre Trump si, poussée par les circonstances de la marche à la guerre et de la crise économique, la bourgeoisie américaine devait exiger l’enrégimentement de la population.
Les propos que Trump tient depuis la Maison-Blanche peuvent inciter tout ce que le pays compte d’apprentis fascistes à le prendre au mot, lui qui a répété en boucle qu’en plus des migrants, l’Amérique était menacée par le complot communiste, le wokisme ou les personnes transgenres.
Pour l’instant, la bourgeoisie américaine n’a pas besoin de pousser plus en avant ces courants politiques d’extrême droite. La politique de Trump, appuyée sur les moyens de l’appareil d’État, lui suffit. Mais en cas d’aggravation brutale de la crise, elle pourrait financer ces courants et les pousser à agir, par exemple contre des piquets de grève.
Ce qui est certain, c’est que pour se protéger de la violence d’extrême droite ou des brutalités des policiers les plus zélés, les travailleurs et tous ceux que vise la haine raciste ou sexiste ne pourront compter que sur leur sens de l’organisation et sur l’autodéfense.
L’appareil d’État secoué
En capitaliste décomplexé qui ne tolère aucune limite à sa soif de profits, Trump exprime sans filtre les aspirations de sa classe. Il a annoncé qu’il réduirait les impôts des entreprises, briserait les réglementations dans l’industrie et la moindre entrave à la liberté d’exploiter. Il vient de lever des restrictions à de nouvelles opérations de forage pétrolières en Alaska, prétendant qu’accroître la production ferait baisser les cours, donc l’inflation et qu’ainsi la banque centrale (Fed) abaisserait ses taux, ce qui relancerait l’économie et créerait des emplois. Dans sa bouche, enrichir les majors du pétrole est bon pour les travailleurs…
Trump fait aussi la publicité des coupes budgétaires massives qu’il souhaite dans les dépenses de l’État fédéral. Il a ainsi créé un ministère de l’Efficacité gouvernementale (DOGE), ou plus exactement une commission, dirigée par Musk. Une équipe d’ingénieurs âgés de 19 à 25 ans s’est ainsi vu confier par Musk la tâche de faire la chasse aux dépenses jugées superflues. Leur premier fait d’armes est d’essayer de supprimer purement et simplement l’agence d’aide au développement des pays pauvres (USAid, dont la fonction fondamentale est de camoufler les méfaits de l’impérialisme américain dans le monde par des actions humanitaires), d’annuler les financements qu’elle octroie et de mettre ses salariés à pied.
Musk et Trump ont aussi dans leur viseur quelque 2,2 millions de salariés qui travaillent pour l’État fédéral. C’est ainsi que, fin janvier, ces derniers ont reçu un e-mail du bureau des ressources humaines les invitant à démissionner immédiatement contre paiement de leur salaire jusqu’en septembre. Cet e-mail promet des coupes dans les effectifs, surtout de ceux qui travaillent pour les services de retraite, du logement ou de la santé, c’est-à-dire ceux qui sont utiles à la population. 75 000 fonctionnaires fédéraux auraient déjà démissionné, certains par peur de ce chantage, d’autres refusant de travailler pour un tel gouvernement.
Les attaques portées contre les programmes sociaux et les services fédéraux qui y sont associés toucheront en premier lieu les classes populaires noires, que Trump vise indirectement lorsqu’il dénonce les politiques « de diversité et d’inclusion ».
Cela fait des décennies que les administrations démocrates et républicaines cherchent à s’attaquer aux employés fédéraux pour réduire le déficit budgétaire. Ils répondent aux désirs de la bourgeoisie américaine, qui réclame une part grandissante d’argent public sous forme de subventions en même temps qu’une baisse de ses impôts.
Musk et son DOGE s’arrogent ainsi le droit de passer en revue les dépenses de l’État fédéral et d’annuler celles qui ne profitent pas directement au grand capital. Ils traquent d’éventuelles ou d’imaginaires malversations pour supprimer telle ou telle dépense ou limoger tel haut fonctionnaire suspecté de s’opposer à Trump, et faire place aux amis du nouveau pouvoir. Quel rêve pour un multimilliardaire que de peser directement sur les finances publiques !
Dans ce feu d’artifice, l’activisme du DOGE n’est pour l’instant que purement verbal vis-à-vis du puissant Pentagone. Cette administration militaire gère un des plus gros budgets fédéraux, source de multiples scandales financiers tant les généraux et amiraux à la retraite peuplent les conseils d’administration des entreprises dont les armées sont les clientes. Trump ira-t-il jusqu’à s’attaquer à la hiérarchie militaire, qui est le principal pilier de l’État qu’il dirige et dont le rôle est primordial dans la puissance de l’impérialisme américain ?
Pour le moment, seuls quelques juges et hauts fonctionnaires entravent un peu cette politique qui vise l’État fédéral. Jusqu’où Trump la mènera-t-il ? Aussi loin qu’elle correspondra à la volonté de la grande bourgeoisie américaine qui, pour l’instant, n’incite pas ses relais parmi les politiciens républicains du Congrès à le freiner. Ou tant que sa politique ne provoque pas une hostilité telle que la population, et en particulier la classe ouvrière, se mobilise.
Les secousses que Trump impose à un appareil d’État pourtant entièrement au service de la grande bourgeoisie sont en partie dues à son désir de vengeance après quatre années pendant lesquelles la présidence lui a échappé. Mais cette centralisation potentielle du pouvoir dans les mains présidentielles aurait aussi l’avantage pour la bourgeoisie d’améliorer l’efficacité de son État. Avec un Congrès sans majorité claire, démocrate ou républicaine, qui ralentit souvent la vitesse des décisions au sommet de l’État, avec des juges qui contrecarrent parfois leur exécution, avec des États fédérés et des grandes métropoles qui forment des pouvoirs locaux ayant leur propre politique, la bourgeoisie américaine peut être handicapée par cette architecture étatique héritée du passé. Quand l’avenir est à la confrontation avec les autres puissances, donc à la mise au pas des populations, les États bourgeois trouvent avantage à l’autoritarisme.
La tradition de l’impérialisme américain
Trump dit s’inspirer du républicain William McKinley, président entre 1897 et 1901, à l’époque dite des « barons voleurs », période du capitalisme le plus sauvage où les rois de la banque, du rail, du pétrole et de l’acier, Carnegie, Morgan, Rockefeller ne connaissaient aucune limite à leur liberté d’exploiter et de s’enrichir. Ce passé que Trump trouve « grandiose » est celui où les enfants allaient au travail plutôt qu’à l’école, où leurs parents trimaient 12 à 14 heures en usine, où les milices patronales tiraient sur les grévistes et où les paysans qui résistaient aux banques voyaient leurs granges brûler la nuit et pire encore s’ils se battaient Noirs et Blancs côte à côte.
Sur le plan international, le mandat de McKinley correspondait à l’expansion du jeune impérialisme américain. Les États-Unis chassèrent l’Espagne de Cuba et s’approprièrent Porto Rico. Ils asservirent les Philippines, dont ils firent un protectorat au prix d’une sanglante guerre coloniale, tandis qu’ils avançaient dans l’océan Pacifique en colonisant Hawaï et l’île de Guam. Le parallèle avec les prétentions territoriales de Trump est évident.
Sous McKinley, le budget fédéral était alimenté pour moitié par des droits de douane et il n’y avait pas d’impôt fédéral sur le revenu. Trump voudrait s’en inspirer et parle de remplacer l’impôt sur le revenu, collecté actuellement par l’Internal Revenue Service (agence de l’administration fiscale), par des taxes sur le commerce étranger qui seraient prélevées par une une nouvelle agence, l’External Revenue Service. L’idée de faire payer les frais de leur État par le monde entier doit plaire aux bourgeois américains grands et petits, eux qui profitent déjà de ce privilège que leur monnaie, le dollar, soit le pilier de l’ordre financier international.
Or en 1900, le budget fédéral américain représentait l’équivalent de 3 à 4 % du PIB, contre près de 20 % aujourd’hui. Augmenter les droits de douane ne le fera pas maigrir. Une part importante de ce budget est actuellement consacrée à l’entretien d’un appareil militaire qui compte 750 bases en dehors du territoire américain et d’une armée de 1,4 million de soldats, lorsque son ancêtre n’en comptait, 125 ans plus tôt, que 40 000 et coûtait beaucoup moins cher. Trump ne résoudra pas la crise du déficit budgétaire avec les taxes douanières, pas plus qu’il ne rendra la vigueur qu’il avait à l’époque de McKinley à l’impérialisme américain. Ce n’est pas pour autant que celui-ci ne se prépare pas à la guerre pour conserver son hégémonie. Et à cet égard, l’escalade verbale de Trump sonne comme un avertissement.
Celui-ci multiplie en effet les déclarations aussi guerrières que provocantes, n’épargnant pas même les pays déjà dans la sphère d’influence des États-Unis. Ses déclarations fracassantes sur la possible annexion du canal de Panama, l’achat du Groenland ou le rattachement du Canada mettent à nu le règne de la loi du plus fort. Les alliés sont les possibles proies de demain, tout comme la crise du Covid et la guerre en Ukraine ont été des occasions pour l’impérialisme américain d’affaiblir ses concurrents européens et au premier chef la puissance industrielle allemande. À ce propos, Trump, qui menace maintenant de s’entendre directement avec Poutine pour sceller le sort de l’Ukraine, exprime sans filtre ce qui motive depuis le début le soutien militaire des États-Unis à Kiev : faire avancer les intérêts de l’impérialisme américain. Il conditionne en effet ce soutien à la cession, par Zelensky, des gisements de terres rares du pays, estimés à 500 milliards de dollars et convoités par les entreprises américaines, même si cela fait en réalité des mois que ces accords sont négociés entre l’Ukraine et l’administration Biden.
En France et ailleurs, nombre de commentateurs bourgeois s’indignent que les États-Unis de Trump s’en prennent d’abord à leurs alliés plutôt qu’à la Russie et la Chine, considérées comme les ennemis stratégiques des puissances impérialistes. En réalité, il n’est pas illogique qu’en vue d’une confrontation militaire mondiale, l’impérialisme américain cherche d’abord à se poser en dictateur de son camp, soumettant ses alliés pour en faire des vassaux. Rappelons que, lors des deux guerres mondiales du 20e siècle, la puissance américaine avait non seulement vaincu militairement ses ennemis, mais s’était aussi imposée économiquement et diplomatiquement à ses alliés. Et il n’est pas dit non plus que, dans la période qui vient, la bourgeoisie américaine ne cherche à porter ses coups les plus durs aux pays européens. La Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne sont dans bien des secteurs des concurrents commerciaux plus sérieux que la Chine.
Il y a bien sûr dans les déclarations de Trump une part de bluff. La menace de droits de douane brandie à la face du Canada et du Mexique ne s’est pas matérialisée à ce jour, ces deux voisins des États-Unis ayant choisi de renforcer leurs patrouilles antimigrants à leurs frontières. C’est contenter Trump sans se faire violence.
Le seul véritable résultat obtenu par l’agitation de Trump l’a été dans la chasse gardée des États-Unis qu’est l’Amérique centrale. Une tournée de son secrétaire d’État a permis de tordre le bras aux dirigeants de divers pays pour qu’ils acceptent de recevoir des migrants déportés. Et surtout, il a déjà obtenu du président panaméen que celui-ci se retire du projet chinois dit du « collier de perles » que Pékin orchestre pour faire avancer sa marine marchande. Plus discrètement, en décembre, l’Australie avait de même retourné en sa faveur l’alignement international des îles peu peuplées de Tuvalu et de Nauru, dans le Pacifique, qui avaient accepté un temps les avances de la Chine.
Avec le faible Panama, dont l’existence même résulte d’une intervention américaine au début du 20e siècle, Trump a obtenu facilement son premier succès diplomatique. On saura dans les mois qui viennent si ses gesticulations suffiront à faire plier le Danemark à propos du Groenland ; ou bien la Jordanie et l’Égypte, qui refusent jusqu’à présent de créer sur leur sol d’immenses camps de réfugiés gazaouis, ainsi que l’Arabie saoudite, censée financer ce nettoyage ethnique ; et qu’en sera-t-il du Canada prié de se dissoudre dans les États-Unis ? Le bluff de Trump, même appuyé sur la force de l’impérialisme américain, ne garantit pas le succès. Les soubresauts à venir de la politique internationale donneront des éléments de réponse à la question des limites de la puissance américaine. Pour l’instant la bourgeoisie américaine ne pousse pas Trump à obtenir par la guerre ce qu’il ne pourra pas saisir par l’intimidation.
Il est par ailleurs un facteur que Trump ne maîtrise pas, celui de la possible révolte des peuples confrontés à la brutalité de ses plans, en particulier au Moyen-Orient.
Combattre pour renverser la bourgeoisie
Il est trop tôt pour savoir quelles seront les conséquences des gesticulations et des déclarations à l’emporte-pièce de Trump. C’est le recul qui permet souvent de distinguer la brutalité du bluff. Gaza, l’Ukraine, le Groenland, les migrants, l’État fédéral, la guerre commerciale : pour l’instant, le démagogue Trump multiplie les sorties ordurières. Dans la bouche du président de la première puissance mondiale, les mots ne sont pas que des mots. Les déclarations du braillard de la Maison-Blanche peuvent avoir des effets déstabilisateurs et, sous prétexte de vouloir « régler un conflit » et « faire la paix » en 24 heures, l’administration américaine peut déclencher des crises en cascade, sans en avoir le contrôle. L’impérialisme a beau parler fort et brandir un gros bâton, il ne règle rien pour autant, comme les États-Unis eux-mêmes en ont fait l’expérience amère au Vietnam et, plus récemment, en Afghanistan.
Aux États-Unis même, quelle sera la réaction des travailleurs qui se sont laissé abuser par Trump et sa démagogie, quand la guerre de classe que leur mène la bourgeoisie s’intensifiera et que Trump apparaîtra comme leur ennemi en chef ? Ils seront peut-être les plus déterminés à lutter en s’inspirant des traditions des années 1930 ou des années 1960. Il existe dans ce pays un sentiment d’hostilité au big business largement répandu au sein du monde du travail et des couches populaires. Moins d’un mois après l’élection de Trump, la haine du « Corporate America » (l’Amérique des grandes entreprises) et des financiers de Wall Street a éclaté au grand jour quand le meurtrier du PDG de la plus grande compagnie d’assurances-santé a bénéficié instantanément d’une grande popularité. Toutefois, la conscience de classe est jusqu’à présent trop diffuse pour arracher le prolétariat à son apolitisme qui laisse le champ libre à la bourgeoisie.
Mais qu’un ennemi aussi déclaré que Trump agite l’épouvantail communiste doit être une incitation pour ceux que sa politique met en colère à se tourner vers les idées de Marx et de Lénine et à relever le gant. Lorsque le dirigeant de la première puissance capitaliste mondiale parle ouvertement d’écraser ses ennemis, cela doit sonner comme un avertissement lancé aux travailleurs du monde entier et à tous ceux qui, révoltés par la marche des événements, veulent éviter le pire. Puisque le système capitaliste affiche le visage de Trump et porte l’extrême droite au pinacle, ils doivent se fixer comme but non pas de rafistoler l’édifice du capitalisme pourrissant, mais de le renverser.
15 février 2025